Littérature
Critiques littéraires
-
« S’adapter » de Clara Dupont-Monod (éditions Stock)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix Goncourt lycéens 2021 - Prix Femina 2021 - Prix Landerneau 2021
Comment vivre au quotidien avec un frère « inadapté » ? un enfant toujours allongé, « aux jambes translucides et veinées de bleu » un bébé éternel condamné à ne pas voir ni saisir ni parler ? Comment l’aîné et la cadette ont cohabité avec cet être qui ne disposait que de l’ouïe et du toucher pour être au monde et comment le dernier, né après sa disparition, incarnera la renaissance d’un présent hors de la mémoire, c’est ce que nous donnent à entendre les vieilles pierresrousses de la cour de cette maison cévenole. Attachées aux enfants,elles ont été les témoins de leur histoire familiale ; narratrices, elles seront à même d’exhausser la tragédie au rang de mythe universel
Le titre du roman, à valeur programmatique, n’est pas anodin si on replace l’histoire dans un environnement précis. S'adapter, c'est faire avec et non contre les choses. Affirmait la romancière lors d’une interview. C'est pourquoi j'ai souhaité que le livre se passe dans les Cévennes. A la montagne, si vous ne faites pas "avec", vous ne pouvez pas survivre. La solidarité dans les petits villages de montagne est nécessaire à la survie de chacun. Dès les premiers paragraphes nous « accueillons » les invités qui pour fêter l’événement (la naissance de l’enfant) ont dû emprunter des routes sinueuses minuscules monter descendre arriver à ce hameau cerné par des vagues énormes, pénétrer dans cette cour « île protégée des tempêtes » jusqu’à la deuxième maison à la porte médiévale. Les montagnes sont les « matrones » qui se penchent sur le transat…
C’est que les gens sont d’abord nés d’un lieu et souvent ce lieu vaut pour parenté… En se promenant sur une draille avec sa sœur, le dernier constatera que « les gens d’ici ressemblent à leurs chemins »
Habiter là, cela voulait dire tolérer le chaos. L’aîné dans son intimité avec le frère « aveugle » a décidé d’être « ses yeux » : il lui « raconterait l’écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, le rempart du vieux mur, les reflets cuivrés des pierres
Les occurrences du verbe « s’adapter » même si elles sont peu nombreuses ou relayées par des termes au sens similaire, vont scander les trois récits qui composent le roman. Trois récits, trois points de vue. Trois styles et trois tonalités particulières. La fusion de l’aîné avec son frère est évoquée avec lyrisme, tendresse ; la révolte de la cadette, contre la « fracture » d’une beauté apollinienne, avec une fougue et une violence insoupçonnées ; alors que le « dernier » tel un Sage est comme en « surplomb » il sait qu’il est né avec l’ombre d’un défunt.
Parfois un paragraphe, en une suite énumérative, sert de bilan conclusif (le dernier apprend ainsi de sa sœur les détails de l’existence de l’enfant) ou certains épisodes sont rapportés sous un angle différent, car ils ont été vécus autrement (cette remarque vaut surtout pour l’aîné et la cadette).
Mais d’un récit à l’autre, Clara Dupond-Monod perçoit le moment de « basculement » cette prise de conscience nécessaire à la « survie ». Pour ne pas perdre l’enfant définitivement l’aîné a promis « je laisserai ta trace » ; la cadette effondrée après la mort de sa grand-mère devient un désert froid un bloc de pierre ; elle va œuvrer à une forme de « réparation » (éviter la noyade de la famille). Et le commentaire des pierres -porte-parole de la romancière- à propos de sa métamorphose est très éloquent « elle s’adaptait sous nos yeux comme l’avaient fait son frère, ses parents et tant de gens avant eux, gagnant notre admiration. Le dernier qui souffre de l’indifférence de l’aîné à son égard, et faisant sien son précepte légué intuitivement « on ne peut partager un savoir hors norme qu’avec un être hors norme » se mue en démiurge du Verbe. En osmose avec les éléments, il capte les correspondances secrètes de la nature dans son territoire, or « son territoire » c’est son frère disparu
Et les pierres peuvent jouer le rôle d’oracles (prolepses en écriture) : l’aîné l’âme sanglée de peine a quelque chose d’apaisé ; la cadette trouverait quelqu’un qui lui apprendrait l’abandon (à signaler que seul ce personnage sera identifié par un prénom Sandro) ; déjà elle entend dans le roucoulement de la rivière non plus l’indifférence mais la permission
Dira-t-on un jour l’agilité de ceux que la vie malmène, leur talent à trouver chaque fois un nouvel équilibre, dira-t-on les funambules que sont les éprouvés ? c’est une question que (se) posent les pierres.
Le roman de Clara Dupond-Monod si délicat dans l’évocation des liens fraternels,n’est-il pas la réponse adaptée ???
La mère vient d’immortaliser par une photo la connivence entre l’aîné et le dernier, elle dit à voix basse au père
« Un blessé, une frondeuse, un inadapté et un sorcier. Joli travail »
Excipit lumineux !
-
« Un chien à ma table » de Claudie Hunzinger (éditions Grasset)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Etre à la marge. Vivre en marge. Relier par un crayon le monde des marges et celui du centre ; dans ce coin perdu les bois bannis, - nom lugubre s’il en fut mais fragment d’holocène négligé par le capitalisme ; avec Grieg, le compagnon aimant de toujours ; apprendre et apprivoiser dans une interpénétration des règnes et des espèces ! Et voici que s’invite à sa table une chienne, baluchon de poils gris famélique. Rencontre épiphanique ! Yes, la chienne, gardienne du langage- ; et Sophie la narratrice iront « s’augmentant l’une de l’autre » Pacte tacite dans un monde à vau-l’eau. Présence tutélaire quand jaillit soudain l’incipit qui enclenche le processus de la Création et que triomphe la parataxe. Oui Sophie, la sœur de Janet Frame, citée en exergue et -royale connivence- le titre du roman comme écho à « un ange à ma table ». Janet l’oiseau migrateur, Sophie aux cheveux de ronces, aux yeux de mûres écrabouillées, à la voix d’oiseau ». Etrange étrangeté
Avec ses Buffalos argentées, un corps qui se déglingue (l’épithète déglingué revient en leitmotiv) la narratrice ne verse nullement dans la mélancolie. Le constat est certes amer « où étaient passés mes poignets de perce neige et mon cou d’hermine encadré de deux jolies oreilles si joliment féminines ». Oui certaines « choses » sont désormais impossibles à réaliser « fini les sommets. Fini les forêts. Fini de me lever à l’aube courir les grands cerfs » Mais si le monde est impitoyable s’il est troué rétréci sali il y a encore des merveilles, « entre ses mailles rongées » et des espèces non inventoriées …
Et pour qui sait écouter le chant du rouge-gorge « en suspens de ses larmes », apprivoiser une merlette, les mots des humains et les oiseaux ou plutôt leurs phrasés sont liés, issus du même fleuve Diversité. A nous de les capter dans leur authenticité !
Métamorphoser une soirée en aurore boréale en robe rose et verte. Dans le lit aux côtés de la chienne Yes et de Grieg, la vétusté dans son anarchisme même se drape d’une musique, celle d’une vibration : la respiration du Vivant (oh notre petite communauté ! we few we happy few we band of brothers)
Car il s’agit bien d’une Ode à la Vie où, en une suprême synesthésie, les notes de musique sont des couleurs, les anges de Giotto ont des ailes d’oiseaux, où la musique a un goût d’églantine, plus le goût du conditionnel passé de féerie à fond, où le vent a une tonalité lyrique. Et très vite le rythme des ramures va faire place au balancement des phrases, leurs ramifications à la syntaxe (ma main n’est plus formée de cinq doigts mais de quatre intervalles entre cinq doigts comme si en plus de la pratique de la marche j’avais incorporé quelque chose du feuilleté du liber des arbres. Et l’on comprend pourquoi Claudie Hunzinger dédie son roman à Stonehenge, alias Pierre Schoentjes, professeur de littérature à l’Université de Gand, spécialiste de l’écopoétique.Une de ses études se focalise sur la manière dont des œuvres prennent forme dans un lieu en même temps qu’ils intègrent une réflexion sur la façon d’habiter le monde, aux côtés des « locaux » mais aussi des arbres et des animaux.
Observatrice observée dans La Survivance, la narratrice de « Un chien à ma table » est cette femme ensauvagée et la chienne domestiquée, une gardienne. « on se complète » Sophie, une « femme veillée par son chien » Yes « cette émissaire de l’animalité pansait la femme qui revenait du monde sauvage » Gardienne du langage menacé (sous la table avec Thomas Bernhard Kafka); « je suis ta garde rapprochée »
A la mort de l’ânesse, Litanie, pas de lamento mais ce constat déchirant poignant « nous nous augmentions l’une de l’autre. Un constat qui définit aussi la quintessence de la relation Yes/Sophie
Un chien à ma table. Ce titre de l’aveu même de l’auteur est un titre généreux un titre qui dit « ici on accueille toutes les espèces à table, entrez les bêtes on est à table, on vous fait de la place »
Si je ne te regarde plus, tu disparais
On peut très bien écrire avec des larmes dans les yeux
-
« Taormine » d’Yves Ravey (Editions de Minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix des libraires de Nancy Le livre sur la Place (septembre 2022)
Taormine ou la promessede Vacances réussies ? C’est du moins ce qu’espéraient Melvil et Luisa persuadés que le voyage en Sicile allait reléguer au second plan les tensions de leur couple ! Très vite pour avoir pris un « chemin de traverse » et s’être enfoncé dans des « ornières » (sens propre et figuré) leur rêve va se muer en « cauchemar ».
Sur fond de tragédie des migrants, c’est bien la chronique d’un monde fracturé que propose Yves Ravey et le lecteur sera sensible une fois de plus à sa dramaturgie finement ciselée sous les apparences de la banalité et de la linéarité, à son art de l’épure et de la contention, et son art du récit (temps dilaté ou étréci, intrigue mouvante).
Comme souvent chez le romancier, le personnage-narrateur en rapportant les faits s’exprime au passé composé, soit que les faits ont déjà eu lieu (ce qui autoriserait une certaine mise à distance), soit qu’ils sont dans l’instantanéité de l’écriture (comme dans l’Etranger) mais dans les deux cas c’est une voix off et un point de vue univoque qu’est censé entendre le lecteur ; voix off qui peut se doubler d’une voix intérieure : se parlant à lui-même le narrateur tente de se dédouaner, se conforter dans le déni du réel. C’est que Melvil use et abuse de cette propension à répartir les responsabilités. Sa voiture a heurté un « objet non identifié » et au lieu de sortir du véhicule, de « vérifier », il accuse « autrui », a recours à des prétextes fallacieux, propose « d’oublier cette histoire idiote d’obstacle sur un chemin emprunté par erreur ». Cerné, il s’empêtre (l’auteur se plaît à jouer de la polysémie de certains termes « empêtré, ornières, écheveau ») mais quand la presse évoquera la mort d’un enfant de… migrant… ce sera le triomphe du cynisme odieux… et la fuite !
Oui Melvil est le prototype du salaud (presque au sens sartrien) un lâche un égoïste ! Se sachant traqué (la police enquête ; l’inspecteur Dacosta rappelle étrangement le Columbo, de Costa de « Pas dupe » ; il progresse lentement avec méthode en professionnel de la recherche d’indices), il sera la proie idéale du carrossier véreux (j’ai parlé argent seul mot susceptible de se faire comprendre par le patron du garage vecteur absolu. Ensuite le mot cash, formule magique pour qui fréquente Michelini, suivi du groupe de mots carte de retrait. J’ai aussi laissé entendre que la locution compte bancaire, avait, concernant ma femme, une valeur significative. »)
L’auteur s’abstient de toute approche psychologisante : ce qui compte ce sont les actes décrits et les paroles échangées, pas très nombreuses certes et rapportées au style indirect, et c’est dans l’accumulation de détails, la confrontation des faits, les ellipses et non-dits que se love l’étrange. Une précision atmosphérique, des jeux de lumière, la couleur d’une robe, des dépliants touristiques, le journal sur la banquette arrière, le « moindre » détail peut revêtir une importance capitale. Profusion (de détails apparemment anodins) et parcimonie ; le paradoxe n’est qu’apparent !!
Une entrée immédiate dans l’action (après un très court chapitre qui sert de prologue, apparaissent dès le chapitre 2 les premiers déraillements) et la capacité d’accélération (ce qui n’exclut pas les effets de ralenti) c’est une des constantes dans l’écriture de Ravey, sa dynamique narrative au service d’une mécanique à la fois impeccable et implacable.
Si certaines séquences rappellent la comédie et le suspense : (le couple blotti dans les rideaux assiste à la perquisition de leur chambre d’hôtel…) la plupart s’inscrivent dans une atmosphère lourde qui transforme un lieu de villégiature en lieu d’angoisse, et ce grâce à cette façon de « filmer » volumes matière et perspectives (dans tous les sens du terme) où les personnages « pris au piège » vont se perdre revenir disparaître jusqu’au twist final… Ayant fui leurs responsabilités ils sont désormais des « fuyards » à traiter comme tels…
Luisa et Melvil Hammett (un patronyme clin d’œil au « maître du roman noir » ??) forment un couple « bizarre -dont les infidélités réciproques seront évoquées par prétérition (procédé rare chez Ravey) ; responsables mais non coupables (c’est du moins leur alibi) ils « arroseront » jusqu’au bout en échange du silence. Le garagiste Michelini, Roberto le serveur, la réceptionniste, le policier tous vont palper les billets… Quid de la mort de l’enfant ? La crapulerie comme réaction à une tragédie contemporaine ?
L’auteur ne juge pas. Il donne à voir un monde où « règnent des rapports de domination » que ce soit à l’échelle du couple (Melvil Luisa) de la société voire du monde. Que vaut la vie d’un jeune migrant quand on est obnubilé par ses petits problèmes domestiques ? que vaut la vie d’un enfant de migrant dans un monde corrompu par l’argent ?
Médiocre humanité
-
"Purgatoire" de Dmitri Bortnikov (éditions Noir sur Blanc 2022)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit du russe par Julie Bouvard
Dernier texte écrit en russe par Dmitri Bortnikov (devenu écrivain de langue française) Purgatoire -qui en 2005 s’intitulait « La belle endormie » - a été revu repensé détricoté et retricoté par la traductrice Julie Bouvard avec l’aval de l’auteur. Un nouveau tissu narratif telle une mélopée, « lente immersion dans les replis de l’âme ». Dédié à la mère (comme l’agneau des neiges Rivages 2020) ce récit est composé de trois parties, trois périodes cruciales dans la vie de l’auteur, trois étapes d’un « roman de formation » -l'enfance, le départ à la ville, le retour et la folie de la mère. Un découpage formel qui n'exclut pas de nombreux échos intérieurs, analepses, prolepses et correspondances. Car le texte est avant tout un flux où les strates du souvenir se combinent au gré d’une sensation, d’une association d’idées, dans une langue qui, mêlant tous les registres, peut être crue et poétique, rugueuse et enflammée. Et par un effet de ricochet efficace le « purgatoire » ne serait-il pas aussi celui que va vivre le lecteur happé et comme déboussolé par le vertige de ce chant d’amour et de mort, de cette fresque hallucinée ?
Une fresque : l’évocation d’une enfance au sud-est de la Russie européenne, avec ses acteurs -les membres de la famille la figure truculente de l’oncle, les sortilèges de la sœur et de la mère-, les voisins, les soldats, les tsiganes-, avec sa rivière et son fleuve la Volga l’ensorceleuse, ses forêts, ses animaux, et surtout l’appel de « l’autre rive ». Hallucinée : à l’instar de la petite qui déverse à la « tronche » du narrateur un « torrent de paroles comme si un puits sans fond s’était creusé en elle » (premier tableau qui ouvre le roman et dont le style mêle fantastique, poésie réalisme) ; hallucinée car certaines visions sont exhaussées au rang de fantasmagories (surtout en I et III). Une fresque odorante (fragrance épicée des premières fleurs, bouquet âcre de l’armoise) qui crisse aux premières neiges, qui épouse les spasmes et convulsions de tous les personnages avec une distance ironique qui n’exclut pas l’empathie.
Et l'histoire de ce passé recomposé (la narration est scandée par les formules « je me souviens » « je m’en souviens comme si c’était hier » « je me rappelle bien ») est restituée par "flashes" ou par séquences plus ou moins longues, où un souvenir en entraîne un autre en une arborescence mémorielle. Le narrateur ouvre la porte de l’étable comme il ouvre celle du souvenir (d’ailleurs la coexistence de l’imparfait et du présent dans un même paragraphe le prouverait aisément). Et si des détails reviennent à intervalles réguliers (la verrue sur l’oreille de l’oncle, le tressage des cheveux de la mère, la barque, la nage, par exemple) c’est que s’imposant au moment de l’écriture ils se colorent d’une empreinte particulière selon le contexte de la narration dépendante elle-même du(des) souvenir(s).
À certains moments le narrateur semble s’adresser à un auditeur/lecteur fictif en l’interpellant « si vous les aviez vues », « je vous le dis franchement », « je ne vous l’ai pas dit ? attendez ne partez pas restez un moment », « vous comprenez ». Simple afféterie de langage ? Procédé de dédoublement ? Désir de faire partager ? C’est tout cela à la fois. Le lecteur est, qu’il le veuille ou non, « embarqué » dans cette « aventure ».
Moins volcanique, moins torrentiel que « le syndrome de Fritz » (hormis en I) ce récit peut se donner à lire comme un roman de « formation ». À son retour de la ville - où le narrateur avait fait des études au lycée technique, (section boulangerie) où l’apprentissage d’un « métier » s’était conjugué avec la découverte des vilénies des « autres » - le village de l’enfance s’est métamorphosé. Ou est-ce son propre regard qui l’a transfiguré ? Aux changements inéluctables (technologiques par exemple) s’est superposé le basculement dans la folie d’une mère. La mère figure tutélaire et ensorceleuse, la mère qui ne pourra survivre à la noyade de sa fille bien-aimée Olga !!
Si la « vision de la dame à la faux » ouvre la troisième partie -qui voit défiler les souvenirs des « morts » (l’arrière-grand-mère en bottes sales, Pépé Vania allant « au-devant de sa fiancée », la sœur Olga, la mère) -, force est de reconnaître que le thème de la mort est omniprésent dans ce récit. La mort comme leitmotiv. La mort en héritage. La mort double (ou compagne) de ce spleen des steppes fortifié à la tourbe et aux rêves ?
Le temps des morts sereines est définitivement révolu. La mort de Félix clôt la première partie dans une coda désenchantée -ou résignée- « c’est ce qui nous attend tous ». Enfant, le narrateur est bouleversé par les « berceuses » car « il y a de la mort en elles » et il s’endort avec ce père… absent… dans le jardin de la traîtrise. Évoquée avec poésie comme pour l’exorciser (l’institutrice anglaise, cette jeune femme au coeur brisé qui s’en est allée dans sa barque de fête ; le mort baigné de l’éclat miellé de la bougie), plus frontalement (la pharmacie où travaille la mère est perçue comme l’antichambre de la mort), avec ironie (Fiodor en quittant la terre rejoint Saturne « la planète des cirrhoses et de Hamlet »), la mort est ce linceul qui s’en vient draper l’écriture !! (en ce sens « purgatoire » n’annonce-t-il pas Repas des morts et son mode incantatoire ?)
-
"La vie joue avec moi" de David Grossman (Seuil 2019 et Points 2021)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l’hébreu par Jean-Luc Allouche
Eva Panic Nahir -qui a raconté les horreurs de Goli Otok, l’île-goulag de Tito- est une femme célèbre et admirée en Yougoslavie. À sa demande, le romancier israélien va écrire l’histoire de sa vie et celle de sa fille Tiana Wages ; il sait gré à ces deux femmes de lui « avoir laissé entière liberté non seulement de rédiger l’histoire mais aussi de l’imaginer et de l’inventer ».(cf. chapitre remerciements)
Dans La vie joue avec moi, l’auteur nous invite à suivre quatre personnages, caméra au poing, sur les traces d’un passé, jusque-là recouvert de silence. Voici Guili la narratrice, fille de Raphaël et de Nina, elle-même fille de Vera Nowak, juive yougoslave immigrée en Israël. Gamines, Nina et Guili ont été abandonnées, trauma matrilinéaire indélébile ? Une histoire d’abandon, une famille bousillée. Pourquoi ?
On vient de fêter les 90 ans de Véra au kibboutz avec la présence exceptionnelle de Nina ; Guili invite son père documentariste à réaliser un film sur Véra… in situ… en Croatie. Une remontée aux sources, avec arrêts sur images. L’enquête sur ses racines comme quête existentielle ? Comprendre le passé ? à défaut de le réparer ?
Je souhaite remonter à la genèse, à l’incubateur de la familleavoue d’emblée Guili et les occurrences du mot « racines » ou de termes au sens similaire reviennent à intervalles réguliers. La séquence d’ouverture -rencontre Raphaël/Nina en 1962 et le KO de l’adolescent de seize ans- est la scène inaugurale, celle qui libère Raphaël des tourments dus à la perte de sa mère, celle qui conjure son mal, celle qui le fige pour quarante-cinq ans dans la grâce de « la main tendue ». La « fondation de la famille », de « sa » famille Guili l’imagine dans le trio que formaient alors Touvia Bruck son grand-père paternel, Véra sa grand-mère maternelle et Raphaël son père ; quant à Nina sa mère « son absence a toujours été sa seule contribution à la famille » Famille équilibrée ? alors, là, Guili, chapeau pour l'oxymore !
implant dentaire Turquie Définition d'un implant dentaire Les implants dentaires sont des racines artificielles en titane qui remplacent une racine dentaire quand celle-ci est tombée ou a dû être extraite. Inséré dans l'os de la mâchoire, ils sont destinés à créer un ancrage capable de recevoir une prothèse dentaire amovible ou fixe. Le matériau utilisé est le titane. Le titane est parfaitement biocompatible, aucune intolérance n'a été démontrée à ce jour. De plus, de nombreuses études montrent que l'os vient naturellement se coller au titane. Le phénomène de l'ostéo-intégration comme une liaison directe entre l'os et le titane, résiste aux forces de la mastication et fiable dans le temps. Cela explique le succès de la technique implantaire. Les implants sont une alternative fiable et économique à la pose d'un pont ou d'un appareil amovible.
La complexité des rapports mère/fille, l’incompréhension et la « rancune » sont au cœur de ce roman. Pourquoi Véra, condamnée aux travaux forcés a-t-elle « sacrifié » Nina sa fille de six ans? Véra cette femme « qui a trop aimé ». Véra qui a refusé de signer une « décharge » entachant la pureté de l’engagement de l’être aimé Milosz Nowak. Or l’idée même d’un choix ne s’imposait pas… Pourquoi Nina a-t-elle abandonné sa fille Giuli de trois ans et demi ? (« Véra qui a trahi Nina qui m’a abandonnée moi » songe Guili alors qu’ilsse rendent en Croatie « il n’y a pas de rattrapage en matière d’amour maternel ». Et pourtant !!
La complexité relationnelle est illustrée sur le plan narratif par tout un enchevêtrement de va-et-vient qui se télescopent ; strates temporelles, surimpression de souvenirs, enchâssement de récits, film en train de se faire (avec choix des cadres des angles de vue, de la bande-son) et ses commentaires, (comme un making of) prise de notes (elles serviront au montage). Ainsi grâce à la caméra souvent subjective grâce aux dialogues aux souvenirs et par la distance entre le « je » et le « elle » (à l’instar d’ailleurs de Nina-du-futur et Nina-présente) vont apparaître sur le théâtre des idées comme sur celui de la vie, trois générations incarnées par trois personnages féminins !! Quand le réel manque de « consistance » Guili pallie cette lacune en « imaginant » (je devine, j’imagine) avec parfois des redites volontaires (affèterie ? coquetterie ?) « Je ne me souviens plus si je l’ai déjà mentionné ».
Vers la fin, après les « révélations » et la nuit passée seuls sur l’île les quatre personnages ont l’air d’un quatuor en train d’accorder ses instruments avant un concert.
Le retour en Croatie, la « visite » de l’île de Goli Otok, la « confession » de Véra participent en effet à la « scène de l’amour retrouvé ». Revoir le village natal, se remémorer la rencontre amoureuse, se rappeler les affres de la détention en un long récit (avec changement de police), celui des tortures infligées à l’époque titiste dans le goulag de Goli Otok, aux prétendus traîtres, suppôts de Staline, celui du corps qui s’étiole pour laisser vivre un plant sur la montagne pelée, celui d’un amour absolu, -qu’elle vouait à Milosz Nowak-, tout cela par l’effet d’une alchimie mémorielle va tuer les « fantômes » (dont la trahison) qui jusque-là hantaient les consciences. Un amour désormais débarrassé du ressentiment ? Plutôt acceptation de « la souffrance de l’autre », réappropriation de l’expérience traumatisante- et pour paraphraser le titre du roman acceptation du « jeu de la vie ».
La parole, l’écriture -même si elles portent en elles leur possible disparition- n’ont-elles pas la force de témoignage ? lequel ne peut jamais appartenir complètement au passé… tant il est vrai qu’il se « prolonge » hic et nunc.
Le grand-père Touvia Bruck était agronome et Guili se rappelle ses propos « certaines plantes n’ont besoin que d’un grain de terre pour germer ». Véra, dont les doigts ont été mordus par Raphaël, caresse de ses pouces les paumes de l’adolescent « ainsi un grain de terre peut suffire à deux personnes quand elles sont suffisamment désespérées ».
À cette remarque liminaire, répond en écho l’excipit du roman : Nina, la fille de Guili, est
« mon grain de terre »
« le nôtre » :
Détachés typographiquement, ces deux constats n’ont-ils pas la beauté convulsive de tous les enfantements et ne résonnent-ils pas comme un allegro sostenuto… ?
-
"La fille qu'on appelle" de Tanguy Viel (éditions de Minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Si la quatrième de couverture peut inciter à l’achat d’un ouvrage, elle se contente souvent d’évoquer le « fil conducteur » mais ne saurait rendre compte de ce qui est la force principale, la quintessence : le style. Que serait un « fil narratif » sans la spécificité d’une écriture si particulière à laquelle Tanguy Viel nous a habitué -légère dans sa complexité même, avec ses distorsions temporelles, ses ruptures syntaxiques, ses phrases longues et sinueuses, la rigueur de la construction, le souffle de l’émotion. Comme dans Article 353 du code pénal (2017) « l’intrigue » de « La fille qu’on appelle » prend la forme d’une déposition. Celle de Laura, qu’un « je » extérieur insère dans le récit d’une « descente infernale ». Le lecteur -à l’instar des deux policiers- est invité à écouter cette plainte.
« Dans les divers arts, et principalement dans l'art d'écrire, le meilleur chemin entre deux points même proches n'a jamais été, ne sera jamais et n'est pas la ligne droite » (Saramago) !
Dès l’incipit, la fusion des styles direct et indirect, le jeu des pronoms « elle » et « je » et l’emploi du conditionnel mêlé à l’imparfait ou au futur entraînent le lecteur dans un « avant » ; en fait il s’agit de la déposition faite par Laura, qui rappelle, face à deux policiers, son premier rendez-vous avec le maire (et puis donc elle a repris son récit). Déposition revisitée dès le chapitre suivant par un narrateur omniscient, (emploi du pronom « je »), qui fait entrer en scène Max le père de Laura et chauffeur du maire Quentin Le Bars. Max en père aimant sollicite un emploi pour sa fille (qui a quitté Rennes), Max boxeur attend fébrilement son « gala du 5 avril » (cette date-butoir, comme un mélange de prolepse et d’analepse (cf fin première partie « sauf que le 5 avril c’était demain »).
Coulissement du présent au futur dans le passé, énoncé de vérités aussi violentes que leurs sous-entendus (la force accusatrice ou disculpante du « paraître » par exemple), va-et-vient entre un « je » et un « elle » (qui le met à distance) rôle d’un narrateur censé commenter, contextualiser, dire, deviner ce que les personnages occultent plus ou moins délibérément, c’est ce qui prévaudra tout au long du roman. À cela s’ajoutent des procédés cinématographiques (grand angle, vues en plongée, montage alterné quand Max attend au volant de la voiture et que le maire…), des évocations de paysages d’ambiances et des références à la mythologie qui exhaussent le récit au rang de « tragédie ».
Les insinuations plus ou moins salaces des policiers, désarmés face à la franchise, la lucidité de la plaignante (dans la deuxième fois il y a les suivantes), leurs interprétations disculpant le maire en faisant valoir l’argument du « consentement », les privautés du maire -dès le premier entretien- jusqu’à…, en passant par la phase anticipatrice de l’innocence (séduit malgré lui par une salope), la collusion entre les « pouvoirs » incarnés par ces VIP qui se côtoient au Neptune (casino géré par Franck Bellec), une succursale de la mairie surnommée « ministère des finances », tout un agencement arachnéen de faits qui vont précipiter le père et la fille dans une « souricière » aux odeurs de soufre (ce qu’avait pressenti dès le début Franck Bellec en comparant Laura à un baril de poudre et Max le père à l’allumette qui ne demandait qu’à être craquée »).
Composé de deux parties ce roman enchâsse donc plusieurs niveaux d’écriture et de « récits » ; celui d’une déposition (que scandent les expressions a-t-elle dit, elle a dit, je peux vous dire) mais où Lauradonne l’impression d’être comme extérieure ; le récit-analyse de cette déposition -tel un making of- avec ses arrière-plans (évoqués sous forme de flashback) où l’environnement -et particulièrement la mer-, joue le rôle de personnage (prolongement ou métaphore des sentiments éprouvés par le(s) personnage(s)) où la suggestion prime sur la description en faisant de la « géographie » de la ville une « géographie » intérieure.
La première se clôt sur les révélations d’Hélène -la sœur de Frank- révélations qui sur Max font l’effet d’un uppercut. La seconde s’ouvre sur la défaite de ce même Max, terrassé sur le ring par son adversaire Costa, ce 5 avril. « Version compressée de son existence » et cette affiche qui le nargue !!! Absenté du monde. Puis tout semble se précipiter : dépôt de plainte -la longue pelote de récit, une histoire d’emprise, celle que précisément nous avons lue, entendue en I; la contrattaque de Le Bras et Bellec (des photos de Laura posant nue), la pusillanimité de l’avocat de Laura, la venue de Le Bars ministre, l’évasion de Max et son « geste »… L’affiche (symbole de la « renaissance » de Max) a subi les outrages de la pluie et du vent et pourtant suaire périmé elle continue à porter dans ses déchirures le portrait intime du véritable Max celui dont le cerveau tel un cerf-volant « vous soulève et suspend la tête en l’air dans les cieux.
Et la séquence finale qui emprunte autant au théâtre qu’au cinéma (délimitation de l’espace, rôle muet de certains acteurs, échange de regards, estrade devenue ring, Max/ Spartacus et les mâts des bateaux comme arbitres, Max /Neptune armé de ses gants /trident) est un modèle d’écriture, de suspense, d’ironie aussi dans la « célébration » de la vengeance.
Dans un monde normal on n’aurait jamais dû se rencontrer ! affirme Laura tout au début du roman… mais qu’est-ce que vous appelez un monde normal ? ils ont demandé. Je ne sais pas… Un monde où chacun reste à sa place. Un mondeoù Frank obéit au maire et le maire obéit à son désir ; un monde « à la vassalité tordue », un monde oùla « parole » des nantis, des édiles ou des « politiques » a le primat -par le jeu d’euphémismes, de circonlocutions, de dénégations – sur celui des « administrés » (il faut entendre cet élu local, devenu ministre, ce Quentin Le Bars, clamer son respect et son amitié pour celle qu’il a pris plaisir à abuser !! ), un monde où la parole des gardes du corps « ta gueule » fait office de sésame, -la trivialité ailleurs fustigée est ici tolérée-, un monde où le langage des « oubliés » des « invisibles » est bafoué (à l’instar de leurs locuteurs). Or « celle qu’on appelle » en « osant » prendre la parole contre le « patriarcat », n’a-t-elle pas dérogé à cet « ordre » ?
Un père et sa fille, Max et Laura, tous deux victimes du cynisme ambiant : père « coupable », fille « affabulatrice » mais le « dépositaire de l’autorité publique » sortira « grandi » !
Ainsi va le « monde normal » -quibroie les humbles et affranchit les puissants, ordures comprises (Jérôme Garcin)
-
"Une sortie honorable" d’Éric Vuillard (éditions Actes Sud)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
C’est à un nouveau défi que nous convie Eric Vuillard dans « Une sortie honorable ». Pour « raconter » la guerre d’Indochine et plus particulièrement la défaite de Diên Biên Phu, en 1954, qui met fin à la présence coloniale française, le voici qui furète dans l’ombre, investit les « coulisses », met en scène jusqu’à la farce caricaturale parfois, des personnages politiques, des banquiers connus (ou non) du public, interroge le langage et ses mesquines hypocrisies, en stigmatisant les crimes des « dominants ». Le titre, modèle d’antiphrase, il l’emprunte au président du Conseil René Mayer, de même que la photo qui figure sur la page de couverture -le couple de la Croix de Castries apparemment heureux- prise en 1954 serait un modèle d’illusion ! Et comme dans ses précédents récits, l’auteur met en résonance passé et présent, ce dont témoignerait aisément une construction « circulaire » ou du moins une forme de « continuum » métaphorisé par les « fils » (de fer ou d’or). Un récit vif, alerte servi par une écriture inventive et facétieuse.
Composé de 22 chapitres, il suit un ordre chronologique -de la défaite de Cao Bang contre le Viêt Minh, à celle de Diên Biên Phu- avec une séquence d’ouverture située en 1928 qui joue le rôle de prologue et la défaite de Saïgon en 1975 celui d’épilogue, en passant par les discussions houleuses à l’Assemblée, et sa galerie savoureuse de portraits, les descriptions précises des lieux stratégiques, les préparatifs et les conséquences, et des considérations sur un système d’exploitation forcené de l’homme par l’homme !
Et pour chacune de ces scènes/séquences (consacrées à un personnage ou à un épisode de l’histoire) le rythme de la phrase, la profusion de détails, le jeu de flash-back (car par souci pédagogique il faut remonter dans le temps) ou de prolepses (comme procédés d’attente), l’alternance entre présent dit de narration et passé simple, les anaphores qui scandent un paragraphe, les exhortations au lecteur et l’ingérence-immixtion du « narrateur » (emploi du présent de vérité générale, emploi du pronom « je » ou de l’adjectif possessif « nos ») contribuent non seulement à rendre le récit très vivant, mais à solliciter une « participation » active du lecteur en lui proposant un autre regard sur des faits avérés, en les contextualisant et les inscrivant dans une Histoire plus large.
En tant que forces dynamiques, continuum et enchevêtrement assurent une forme de tempo ; bien que de nature différente -idéologique et narrative-, les deux s’entrelacent ou sont concomitantes. Si le roman s’ouvre sur des extraits d’un guide de voyage sur l’Indochine de 1923, n’est-ce pas pour dénoncer l’hypocrisie du langage ? Laquelle prévaudra dans la séquence suivante de ce même chapitre (1928 des inspecteurs mandatés par la France découvrent les horribles conditions de travail des « employés » dans la plantation Michelin ; leur rapport restera lettre morte) et dans nombre de chapitres suivants (circonlocutions dans les discours des députés à l’Assemblée en 1950, correspondances officielles, interview télévisée ou procès). Quelle que soit l’époque, quel que soit le locuteur, (hormis Mendès-France, modèle de lucidité, et François Mauriac) c’est le même cynisme éhonté, la même dénégation, la même dissimulation. À cela s’ajoutent les pouvoirs quasi démoniaques des banques (dont celle d’Indochine à une époque) leur mainmise sur l’ensemble des activités économiques par l’intermédiaire de filiales -bois, or, cuivre, ciment, « nous voyons bien que nous marchons sans cesse dans les mêmes traces, que nous nouons toujours les mêmes fils autour des mêmes pantins, et ce ne sont pas des fils de fer attachant des poignets faméliques, ce sont des fils d’or liant et reliant les mêmes noms, les mêmes intérêts… On croiserait les mêmes cent fois comme on croisait jadis le même hévéa transplanté des milliers de fois dans la plantation de Phu-riêng ». La reprise des mêmes expressions, la répétition de l’épithète même s’inscrit à la fois dans une construction « circulaire » (narration) et une diatribe contre la toute-puissance maléfique de la finance (qui sévit encore de nos jours) sur fond de « refoulé colonial » (c’est entre autres contre cette vision de l’histoire qui oppose dominés et dominants, que s’est insurgé J.C. Buisson, dans le Figaro, accusant É. Vuillard d’être l’adepte d’une littérature postmarxiste chic et choc et de biaiser l’histoire dans un livre ennuyeux. Ne cédons pas à la polémique facile, n’intentons pas un faux procès ; rappelons simplement l’objectif poursuivi par Éric Vuillard de récit en récit, réinventer un discours littéraire possible à partir du fait historique.
Que pouvait signifier l’expression « une sortie honorable » au moment de la guerre d’Indochine ? sinon qu’il fallait relancer la guerre pour en finir et reconquérir une partie de l’Indochine avant de la quitter ? (Chapitre 9 « une sortie honorable »). N’est-ce pas au final le dispositif essentiel d’une entreprise coloniale ?
Et voici que résonne l’explicit tel un uppercut émotionnel et politique
« Dans l’espérance d’une « sortie honorable » il aura fallu trente ans et des millions de morts… trente ans pour une telle sortie de scène. Le déshonneur eût peut-être mieux valu. »
-
"Poussière dans le vent" de Leonardo Padura (Editions Métailié)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l’espagnol (Cuba) par René Solis
Dans ce roman à la chronologie éclatée, au jeu incessant d’allers-retours, Leonordo Padura avec ce sens du récit -qui peut rappeler le roman policier- sa science du montage qui nous fait passer avec fluidité d’une temporalité à l’autre, sa maîtrise des analepses et prolepses, explore une thématique qui le taraude : l’exil. Comment a-t-on pu en arriver là ? Où va-t-on ? Questions lancinantes que se posent les protagonistes de « Poussière dans le vent ». Une génération, celle de l’auteur, prise entre fidélité et trahison, sentiment d’appartenance et déracinement, ce déchirement de se séparer d’une partie de soi, génération confrontée au dilemme : rester ou partir ?Leonardo Padura, lui, a fait le choix de rester à La Havane – même s’il a deux citoyennetés (cubaine et espagnole) il revendique « une seule nation » !!! Clara, le personnage principal du roman, n’est-elle pas son double ? elle qui porte à jamais « sur son dos sa maison culturelle » comme l’escargot sa coquille…
Le titre du roman est emprunté à la chanson « dust in the wind » dont un extrait est cité en exergue. Et un autre jouera le rôle d’épigraphe (dernier chapitre « la victoire finale »). Dès le chapitre II lors de l’anniversaire de Clara (on fête ses 30 ans au Fontanar) Bernardo le mathématicien, mari d’Elisa, a tenu à faire écouter la voix de Steve Walsh (groupe Kansas) et entendre le violon de Robby Steinhardt. (étrange mariage « de la fête et de la mélancolie » songeait Clara !!). Nous sommes en 1990 c’est à ce moment que Walter prend une photo du « clan ». Photo que Marcos (il est alors à Hialeah Miami) a montrée (chapitre I) grâce à Facebook à sa compagne Adela Fitzberg qui, intriguée, est persuadée d’identifier sa mère enceinte (en la personne d’Elisa). Adela, fille de Loreta -elle « aurait déserté » Cuba- et d’un père argentin (du moins est-ce sa conviction), lui Marcos fils de Dario (définitivement exilé en Catalogne) et de Clara (une des rares du « clan » à ne pas avoir « déserté » l’île).Et ce n’est pas pur hasard si le roman s’ouvre précisément sur cet épisode : la photo comme déclencheur… de l’enquête que mènera Adela (Chapitre IV La fille de personne), enquête sur ses origines, sur la génération qui a connu la Révolution, une enquête qui est aussi quête de soi ; une photo prise en 1990 date fatale pour l’avenir du peuple cubain -qui connaîtra pénurie et misère- ; 1990 date dans le roman du suicide de Walter et de la fuite d’Elisa (ces deux drames sont-ils liés ?). Et ce n’est pas non plus pur hasard si le roman se clôt sur le « devenir » des mêmes personnages Adela et Marcos, alors que les « différentes énigmes » ont été résolues et les « secrets » mis à jour… -soit après presque 30 ans d’incertitudes ! Le thème du double Elisa/Loreta, pris dans l’acception de « duplicité » est à mettre en parallèle avec le livre d’Orwell 1984 que les protagonistes avaient lu dès 1981… support à une réflexion critique sur le régime castriste, réflexion qui ébranlera leur foi en l’avenir promis par Fidel Castro, et prémices des « départs » -définitifs, pour certains…
L’enchevêtrement dans le temps et les constants allers et retours entre le passé (début années 1960) et le présent (2016) le télescopage de plusieurs périodes et la reprise -telle une variation- de faits identiques (la photo prise en 1990, le briquet de Walter, le baiser Clara/Elisa, le roman d’Orwell, la sculpture l’Ange déchu inspirée du Laocoon et ses fils entre autres) ne sont pas seulement au service de structures narratives élaborées ni du « suspense » (que le romancier se plaît à entretenir) mais aussi l’illustration de cette foi en la mémoire « se souvenir sera toujours mieux qu’oublier même si c’est un processus douloureux ». À la chronologie éclatée correspond (ou répond) un éclatement géographique (Cuba, Miami, Barcelone, Madrid, Toulouse, Porto Rico, Buenos Aires) qu’incarnent précisément la plupart des protagonistes (les huit du Clan, auquel se sont ajoutés les amis et les enfants) ; éclatement comme métonymie de la diaspora cubaine ?
Poussière dans le ventse lit, s’écoute comme une polyphonie (certains y verront un roman choral, alors que le récit- hormis les monologues ou les lettres- se fait à la troisième personne…) avec ses solos, ses tutti, ses contrepoints, ses leitmotive. Leonardo Padura prend en charge le destin de chacun, et ce faisant il l’inscrit à chaque fois dans un contexte précis (historique social et économique). En traversant différentes époques et différents pays, nous sommes à même de « vivre » un quotidien « vérifiable » (on vilipende le castrisme ? mais ailleurs dans les sociétés dites démocratiques n’est-ce pas le triomphe des effets pervers du libéralisme…) L’auteur ne juge pas ses personnages, tout comme Clara qui, à 36 ans, dans un long monologue intérieur, s’interroge sur le bienfondé de tel ou tel choix et semble les « comprendre » tous… mais « elle ne savait pas encore que la vie lui réserverait de nouvelles séparations plus douloureuses encore ». Dissidence et diaspora !
Sensualité et érotisme, éducation et transmission, politique et histoire, autant de forces vives que le romancier traque, débusque par-delà l’apparente fragmentation – en harmonie d’ailleurs avec la diversité des parcours. Poussière dans le vent : une immense fresque -non sans quelques « rondeurs »- à la fois réaliste et mélancolique, colorée et odorante, truffée de références littéraires et picturales !! Gardons en mémoire les propos d’Adela sur les « émigrés » (chapitre I) « pour avoir vécu parmi des émigrés Adela savait que personne ne quitte l’endroit où il est heureux à moins d’y être forcé -et c’est alors en général qu’il perd le fragile état de bonheur » ou la douleur existentielle d’Irving exilé à Madrid (la conviction de ne plus avoir d’appartenance ne le quittait jamais -chapitre III)
-
"La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr (éditions Philippe Rey Jimsaan)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Mohamed Mbougar Sarr dit s’être inspiré de l’œuvre et du destin de Yambo Ouologuem, mais son roman La plus secrète mémoire des hommes qui vient d’être couronné par le prix Goncourt, n’est en aucun cas une exofiction, et ce, malgré quelques évidentes similitudes -deux jeunes auteurs sénégalais Yambo Ouologuem et T.C Elimane, une œuvre unique Le devoir de violence et Le labyrinthe de l’inhumain, une œuvre vouée aux gémonies et un questionnement pourquoi se sont-ils tus ? Tout au plus l’écrivain malien (1940-2017) sera une silhouette tutélaire. C’est Roberto Bolaño (1953-2003) auteur des Détectives sauvages, et cité en exergue, qui sera le « guide » ; il lui emprunte d’ailleurs le titre de son roman « Un jour l’œuvre meurt, comme meurent toutes les choses, comme le Soleil s’éteindra, et la Terre, et le Système solaire et la Galaxie et la plus secrète mémoire des hommes ».
Diégane Latyr Fay, le narrateur, jeune écrivain sénégalais, après avoir découvert, intrigué, Le labyrinthe de l’humain, va mener une enquête sur son auteur T.C. Elimane, surnommé en son temps, 1938, « le Rimbaud nègre ». Une enquête tel le « froissement de fourrés dans une jungle drue » mais qui est aussi quête de soi. D’où ces deux forces qui animent le roman : questionnement sur l’acte d’écrire, sur la littérature (son essence, sa finalité) et sur soi aux prises avec des contingences érigées parfois en nécessités. Le credo ? ne pas écrire si tu n’as pas l’ambition de faire trembler l’âme d’une personne. Un roman au sujet ambitieux où s’enchâssent de nombreux récits, où se mêlent différents genres littéraires, où une sensualité effrénée peut côtoyer l’autodérision, où le trivial épouse l’érudition, un roman irradié de jeux de miroirs et de mises en abyme, Elimane ou l’allégorie de la littérature ?
Le roman s’ouvre sur un semblant de « résolution » ; épuisé par les récits de l’Araignée-mère (Siga D) le narrateur décide en ce 27 août 2018 de suspendre son journal ; de « fermer sa gueule ». Par le subterfuge d’une chronologie inversée le lecteur se familiarise d’emblée avec le « cercle littéraire » de Diégane, déguste ses appétences, se moque de ses prétentions littéraires (vocabulaire érudit formules amphigouriques) et de ses gaucheries d’amant, s’interroge sur ces nombreux aphorismes au pédantisme teinté d’ironie ! il entre de plain-pied dans les coulisses de la Création littéraire et surtout il est complice d’une fascination : T.C. Elimane a séduit et intrigué par « la facilité de son adieu au soleil, l’assomption de son ombre ». On ne rencontre pas Elimane il vous apparait il vous traverse il vous glace les os et vous brûle la peau c’est une illusion vivante.
Nous voici sur les traces de…T.C Elimane.
À l’instar d’une symphonie, le livre premier joue le rôle d’ouverture ; et le roman obéira à des effets de circularité concentrique : retour des mêmes personnages (dont Siga) avec enchâssement de récits au service d’une évocation toute en entrelacs avec ses glissements ses superpositions ses fondus enchaînés. Une enquête à la complexité dédaléenne -le labyrinthe servant de motif qui relie espace et temps. Ainsi le long récit de Siga (à Paris et Amsterdam) ramène au passé (Siga reproduit le récit de son père Ousseynou Koumakh le mage aveugle) ; car un personnage en appelle un autre, (Brigitte Bollème la journaliste, Thérèse Jacob, Claire Ledig (des éditions Gémi), ou encore la poétesse haïtienne) et le lecteur devenu auditeur peut manifester la même impatience que Diégane. Un même récit peut être repris mais sous une autre forme et avec plus amples informations (celui de Ta Dib la troisième femme d’Ousseynou Koumakh rencontrée au Sénégal) dans ce jeu de pistes qui se confond parfois avec un roman des origines et cet effet de mise en abyme où chaque personnage est un enquêteur sur les traces de… Elimane, lui-même, Ange et Démon, n’était-il pas, lors de son séjour en Argentine, à la recherche de… ?
Multiplicité des points de vue, multiplicité des genres littéraires: le roman de Mohamed Mbougar Sarr mêle avec habileté le journal, la confession, le fantastique, le suspense, le roman d’initiation, des extraits de presse, de correspondance (en italique) échanges de SMS (entre Diégane et Aïda), lettres envoyées par Elimane à son oncle et à sa mère avec insertion d’une lettre de son « père » Assane, long courriel de Musimbwa ou encore au final cette lettre-testament d’Elimane). Multiplicité des approches aussi - littéraire, politique, historique, sociale, voire philosophique - d’un personnage peut-être insaisissable !!! Vertigineuse énergie narrative !
Mais le lecteur était prévenu dès l’incipit: l’œuvre littéraire tout comme les étoiles est vouée à disparaître « D’un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci : l’un et l’autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu’on puisse imaginer, une longue route circulaire, où leur destination se confond avec leur origine: la solitude. Nous avons suivi Diégane de Paris à Amsterdam, de Buenos Aires à Dakar, à la recherche d’un écrivain disparu dont « Une seule de ses pages suffisait à nous donner la certitude que nous lisions un écrivain, un hapax, un de ces astres qui n’apparaissaient qu’une fois dans le ciel d’une littérature » Nous avons interrogé cette voie lactée où brillent ces étoiles filantes, amies d’Elimane (Ernesto et Gombrowicz en Argentine, Mossane la mère qui dans sa folie a réuni forces chthoniennes et apolliniennes) et toutes ces figures tutélaires de Diégane (dont Aïda la journaliste des révoltes populaires et l’amante Je sentais les lents spasmes de son sexe autour de ma verge, et la crue grossissant en elle, et l’étoile blanche en elle qui allait bientôt exploser et éclabousser l’univers jusqu’en ses confins inconnus).
Le fantôme de Madag (Elimane) viendra-t-il murmurer « les termes de la terrible alternative existentielle qui fut le dilemme de sa vie : écrire, ne pas écrire ?
Mais il se peut qu’il n’y ait rien à trouver dans la littérature
Est-ce ce rien « la plus secrète mémoire des hommes »
INDÉCENTE LITTÉRATURE COMME RÉPONSE COMME PROBLÈME COMME FOI COMME HONTE COMME ORGUEIL COMME VIE
-
"Une certaine raison de vivre" de Philippe Torreton (éditions Robert Laffont)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
« L'homme qui plantait des arbres », un viatique ? Dès sa lecture "épiphanique", Philippe Torreton a pris cette nouvelle écrite par Giono, sur lui comme on met un couteau dans sa poche.
Jean Fournier le "héros" du roman "Une certaine raison de vivre" s'en vient recueillir en 1947 les rares objets de feu Elzeard Bouffier, le berger christique, l’homme qui plantait des arbres. Et parmi les objets reliquaire/viatique, un couteau (1947 chapitre 1).
Dans la postface, l’auteur affirme que tout est parti de là « une quête de je ». Qui est le je qui raconte la nouvelle de Giono ? Un narrateur omniscient ? l'auteur provençal ? auquel un autre « je » va rendre hommage, en faisant "vivre" un personnage de fiction Jean Fournier, "rescapé" de la première guerre mondiale… mais "broyé de l'intérieur" et qui apprendra du berger une « certaine raison de vivre ». Seul témoin direct d’un homme exceptionnel, Jean poète et auteur dramatique, va rédiger ce texte/épitaphe gravé dans son élan oblatif, syllabaire pour la mémoire de tous.
Croiser son alter ego -par tout un jeu de miroirs, d’effets spéculaires. Un « je » dont il faut se déprendre et habiter en tant que sujet ? là serait l’enjeu de la création… ? Ecoutons ce « je » multiple dans son unicité même, écoutons ces voix qui, par-delà la fiction, résonnent d’un vibrant hommage à l’homme qui plantait des arbres, écoutons ce concert des vibrations séculaires les "confuses paroles" des "vivants piliers" de la Nature, que sont les arbres.
Le roman se déploie en plusieurs parties de longueur inégale et à la chronologie délibérément éclatée (dont rendent compte les titres réduits à une date, moments forts d’un parcours), tout en obéissant à une construction circulaire. Il s'ouvre sur le voyage entrepris par Jean Fournier convoqué à l’hospice de Banon afin de récupérer les "affaires" de feu Elzeard Bouffier ; et ce qui est annoncé dans ce chapitre liminaire (1947) - la première rencontre en 1913 avec le berger, les traumas de la guerre, Alice et Rachel, le théâtre -, sera repris explicité amplifié - à l’instar de variations ou de leitmotive. En écho, le dernier chapitre 1947 à valeur conclusive -tel un dénouement- réconcilie par-delà la mort, toutes les forces vives que nous avions côtoyées. « Forces » qui avaient pu se contrarier : ainsi la « fugue » de Jean (1922) -il a rejoint le berger sans prévenir les siens-, provoque la « maladie » de sa femme Alice et l’annulation du mariage ! Alice perspicace sait (1925 chap 8) que le « berger était la cause de son plus grand malheur ».
Pour le lecteur c’est le démêlement progressif d’un lacis (Jean et ses visions cauchemardesques qui contaminent son présent, et simultanément Jean et ses visions enchanteresses des hauteurs boisées qui contaminent le style par des jeux de métaphores) ; démêlement d’un enchevêtrement de plusieurs écritures (dont celle en italique des textes écrits par Jean, avec ses idiotismes, sa syntaxe écorchée, son lexique dialectal et qu’apprécie l’acteur Bastien « on y parle comme dans la vie, il n’y a pas une langue mais des langues. Sur les scènes parisiennes on n’en parle qu’une, la même. Tout ce qui est patois, les accents ne servent qu’à ridiculiser un personnage » (1937 chap 12) L’écriture comme force exorcisante ? Oui mais… « à force de côtoyer Elzeard il (Jean) avait compris aussi que les mots devaient être l’ultime recours, une dernière option avant l’incompréhension : le silence, les yeux, le corps ne sont pas muets, aussi avait-il repris ses textes et biffé comme un beau diable tout ce qui lui semblait superflu » (1942 chap 23)
Jean Fournier le jeune homme gracile qui préférait regarder et se taire à la frange du monde, avait été projeté dans la guerre à 21 ans… Un miracle après cinq années d’infanterie « deux bras et deux jambes valides une tête avenante épargnée par l’obus et la baïonnette » ! Et pourtant ! Une démobilisation (1920 chap 4) vécue sur un mode cauchemardesque « ça gueulait, ça essayait de carotter, ça s’empoignait sous les yeux des pandores débordés » Jean a 27 ans ; lui l’amoureux de Virgile et de la poésie ! lui dont le regard juvénile suinte l’enfance ! Derrière son masque de joli garçon une guerre continuait, une guerre sans armistice sans clairon final. Et il écrit pour ses morts dont une suite accumulative d’adjectifs au réalisme cru rend compte (1925 chap 8). De même par un procédé de fondu enchaîné des images du passé peuvent se substituer au présent (images de soldats pétrifiés, un fumoir béance de tranchée). La guerre est devenue cette allégorie qui bringuebale sa carriole dans les crânes à tourmenter ; la guerre qui vient emmerder Jean dans la boutique du tapissier (il voit un soldat mort dégoulinant de chair béante et de sang terreux à la place des rouleaux de tissu), dans l’urinoir du Théâtre des Champs-Elysées (soldat gelé dans un linceul blanc (1921 chap 14) ou encore à l’hôpital où le « chef de service expectore l’ypérite et lui-même remugle le dichlore (1922 chap 17). Car pour lui l’avenir s’est fracassé à Verdun ; le futur est une langue morte. « Je pense que je suis la seule veuve de guerre dont le mari vivant est devant mes yeux » avouera Alice.
Persuadé que le berger allait remettre son cerveau dans le bon sens, que voir le monde avec des yeux sans guerre dedans et des souliers qui ne s’étaient jamais enfoncés dans des poitrails humains décomposés ne pouvait être que salutaire, Jean continue à s’entretenir avec lui par la pensée, quand il ne lui rend pas visite ; un tableau de Lucien Penat « le Bourbonnais » chez son beau-père ressemble étrangement à Elzeard Bouffier qui le regarde… En un long paragraphe (1942 chap 24) au style indirect Jean va « raconter » (il évoqua) à son beau-père la genèse d’une rencontre et ces « milliers de chênes » cette forêt tutélaire alma mater, l’exact contraire de Verdun. Est-il possible, envisageable deconstruire son existence entre ces deux forces antipodales ?
Bastien est seul sur scène pour une ultime représentation « on ne sait rien des arbres on sait tout de la guerre ; ils nous survivent pourtant, ils enfilent les siècles en petits cerceaux. Dans leur bois il y a notre écho ».
Et les mots s’en viennent percuter les pensées de leur auteur, Jean. Ovations FIN
En 1947, à 54 ans Jean est à même de « semer » la Vie.
Il a rangé les linceuls, effeuillé la douceur de la nuit, le vacarme des atrocités s’est tu…
« Fais de chaque seconde une expérience enrichissante. Le présent est la seule chose qui n’ait pas de fin » (proverbe amérindien)
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact






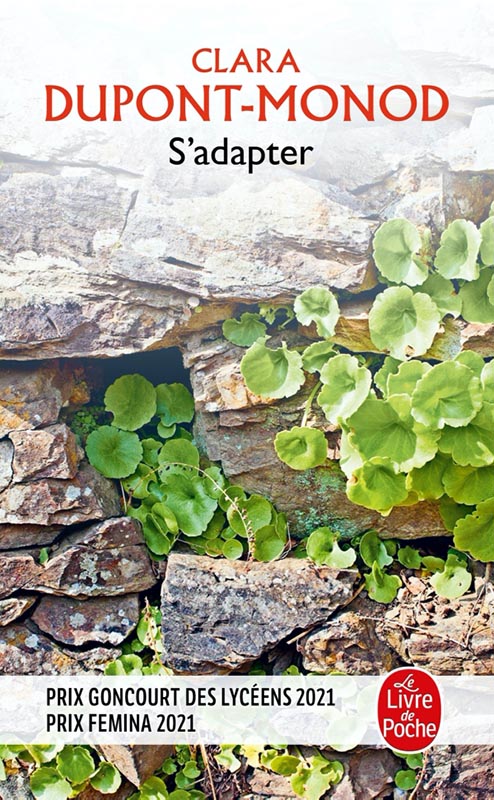

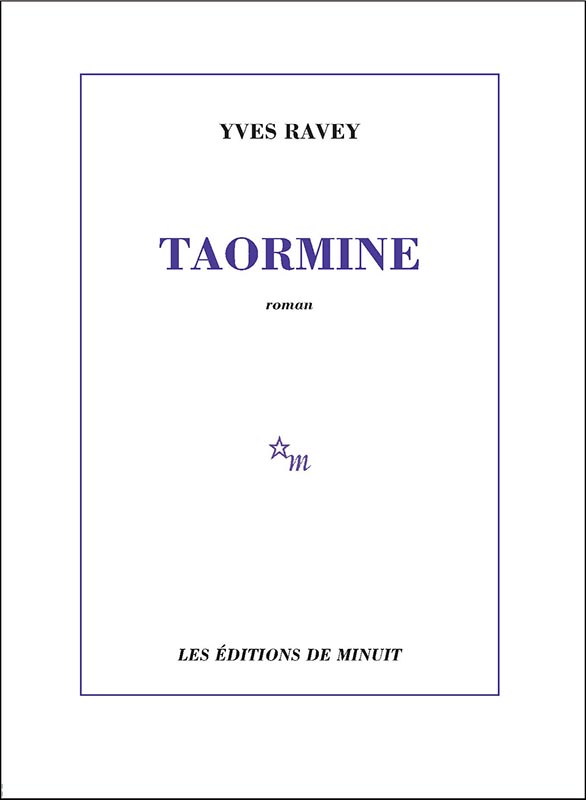
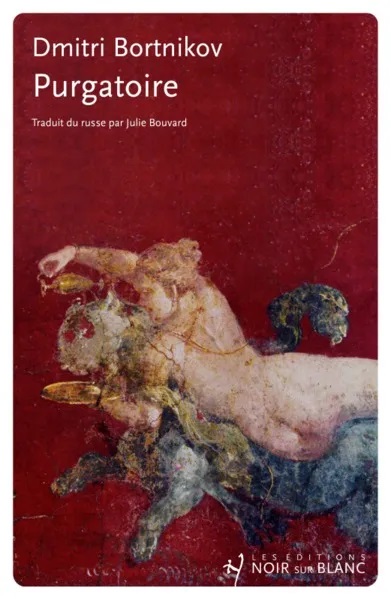
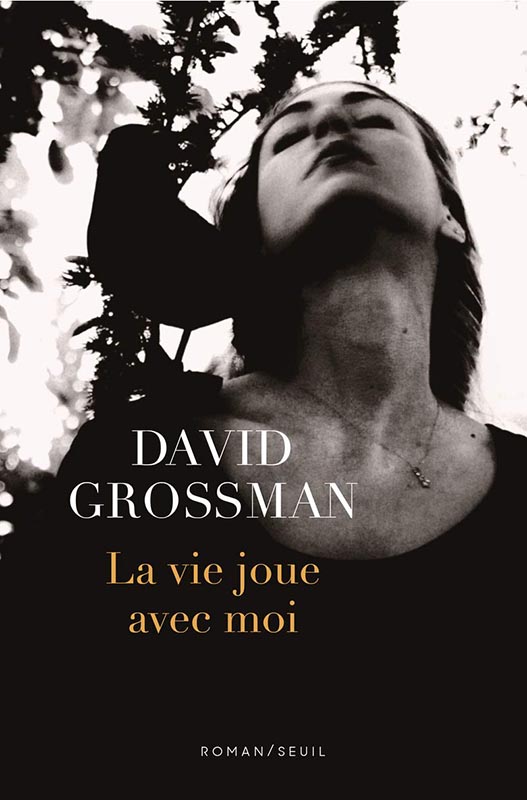
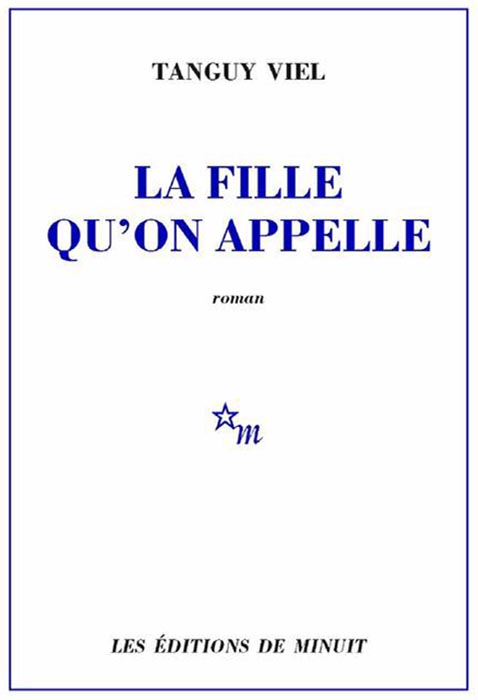
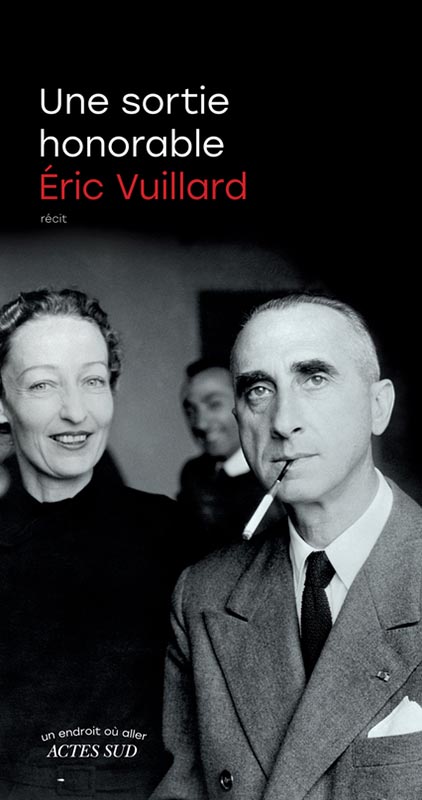
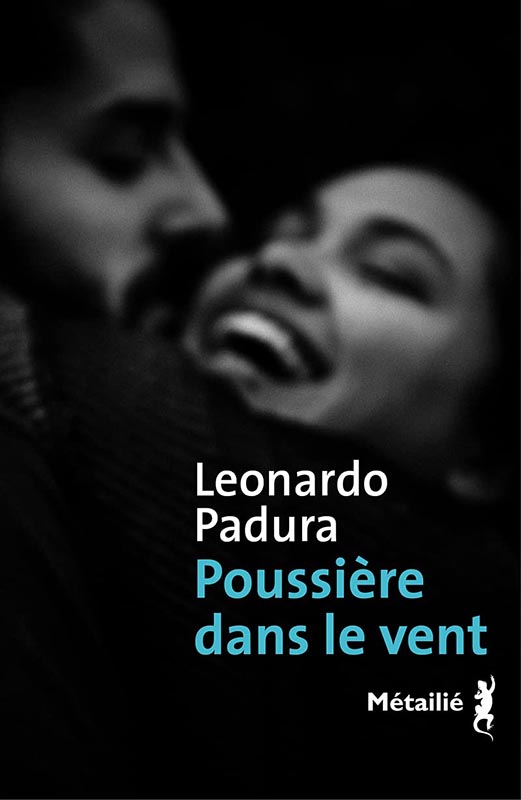
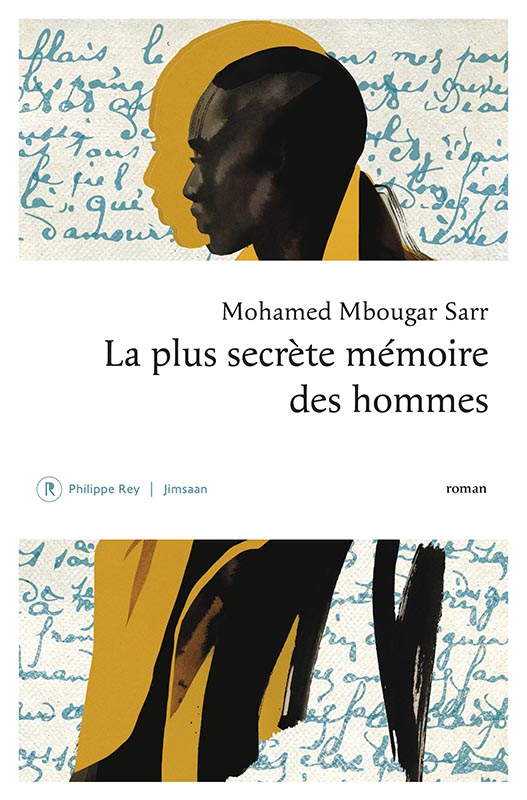
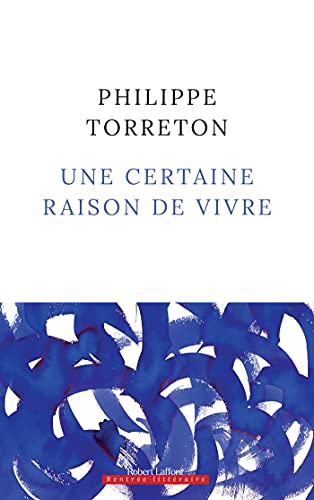
![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)