Littérature
Critiques littéraires
-
Les roses fauves de Carole Martinez (éditions Gallimard)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Dans la sierra andalouse, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort sa fille aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. À partir de ce « matériau » et dans le sillage des femmes brodeuses, Carole Martinez va « tisser » un subtil récit littéraire, où le merveilleux poétique se marie au réalisme le plus cru, où la grâce éthérée épouse la sordidité tragique, autour des dynamiques du désir et de l’amour dont les roses fauves sont la métaphore. Un texte comme textus ! Construire, tresser, entrelacer ! Métamorphoser en personnage de roman cette lectrice qui -lors d’une dédicace de « Cœur cousu »- lui avait raconté la coutume espagnole, superposer à l’histoire de Lola celle du roman en train de se faire (roman dans le roman), les éclairer de fulgurantes coïncidences, d’échos intérieurs, d’effets spéculaires et faire du lecteur un acteur à part entière (Elle- Lola- sera notre œuvre commune notre enfant conçue dans le mitan du livre où nous dormons ensemble lecteur et auteure mêlés dans un même nid de ronces…)
Postière à Trébuailles, Lola, a hérité de sa grand-mère Rosa, elle-même petite-fille d’Inès Dolorès, de cinq cœurs cousus -riches de confessions intimes. Guindée, corsetée dans des principes, serait-elle la seule de la lignée des marcheuses à être sédentaire, car elle boite ? Aurait-elle un lien avec la femme de la carte postale ? Carte qui a décidé du choix d’un lieu propice à l’écriture ? Troublante coïncidence…Toujours est-il qu’elle se lie d’amitié avec l’auteure -comme si elle l’attendait- se confie et accepte de lui faire lire le « cœurblanc qui a craqué le jour de la Sainte Catherine ». Soit 44 feuillets et d’autres non numérotés -ce qui autorisera l’éclatement de la chronologie- ou du moins le va-et-vient entre le moment où Inès Dolorès sent venir la mort et son passé revisité. Une vie de secrets, d’incertitudes enfouies, une vie d’audaces amoureuses, de sensualité effrénée... mais avec la Mort en héritage !! Lecture entrecoupée de pauses, de commentaires et de leur transfiguration dans et par l’écriture. Lecture que rythme la cloche de l’église de Trébuailles. Lecture qui va influer sur le comportement de Lola, et surtout sur le rapport à son propre corps (des caresses nocturnes ont enfanté des roses…). En regardant son reflet dans le miroir, elle reproduit le geste de son aïeule et se sent une vitalité d’adolescente. La quête (l’attente) de l’être aimé s’incarne en la personne d’un cavalier à la gueule de héros. Temps suspendu ! Rencontre amoureuse et chavirement ! Après avoir été muselée, Inès à 16 ans, s’effeuille au miroir en entendant la voix suave d’Augustino… Parée de sa nudité, Lola accueille le « cuirassier »...
Non seulement Carole Martinez se plaît à établir -non sans humour- des corrélations entre les destinées de ces deux femmes -ce dont témoignent le montage et son jeu de raccords- car jadis et aujourd’hui craquent comme des coquilles de noix, secoués par les mêmes rafales, mais le « roman » tout entier est fait d’entrelacs (à l’instar des épineux de ces ronces, « motif » littéraire ou brodé qui permet de relier espace et temps), de glissements, de superpositions et de fondus enchaînés. La mémoire du village c’est Mauricette qui la capte auprès des arbres (merisier), ou auprès de mourants, emplissant ses pots de confiture vides de leurs chuchotements (fable dit le chœur des femmes au tout début du roman, reprise en écho vers la fin par la logeuse) -mais l’auteure se laissera bercer dans ses bras comme dans ceux de sa mère en écoutant l’histoire du village. Lola n’est-elle pasau carrefour de son histoire familiale et de celle du village, au carrefour des vivants et des morts ? Les commérages ce sont les tricoteuses (avatar comique des Parques ?) qui les colportent : ainsi dès le début le lecteur est informé de la présence d’un acteur hollywoodien, auxfesses formidables et dont s’éprendra plus tard… Lola. Acteur qui doit interpréter le rôle de Pierre -parti au front pendant la première guerre mondiale ; sa fleur au fusil ? Marie, boiteuse elle aussi. À la lettre que lui envoie Pierre répond celle d’Henri destinée à Louise. Quand interpréter un rôle se confond avec sa propre vie c’est précisément ce que fait William/Pierre dans sa relation avec Lola/Marie. L’auteure elle-même n’est-elle pas devenue personnage de son propre roman ? Invitant ainsi le lecteur à pénétrer (dans) les arcanes de l’écriture (un roman est un gouffre) avec ses attentes déçues, ses perspectives dédaléennes, (les réseaux souterrains des fougères m’ouvrent un chemin vers mes propres abîmes), ses tentatives de garder le « fil » avec le « réel », avec l’être aimé Laurent -dont l’alliance serait la métonymie- alliance qui se détache, traîne à côté du lit au grand dam de la logeuse Nelly (alors qu’Inès personnage de fiction aura gardé l’anneau d’Augustino comme gage d’amour par-delà la mort,... comme si l’amour éternel n’existait que dans les contes...) mais qui roulera sous les doigts au moment du départ !!! (l’auteure aura quitté son roman pour regagnerle monde).
Si l’écriture propre au merveilleux poétique domine dans ce roman, elle n’exclut pas pour autant la trivialité et le comique. Certains passages mériteraient un commentaire particulier : l’étrange « tête-à-tête » par exemple (deux instances narratives, une Lola jouissant de ses propres caresses dans l’attente de l’être aimé -et la phrase crépite de ses spasmesc- puis empêtrée dans sa gaucherie, un William irrésistiblement attiré par cette femme-fleur, mais ...à la fragilité de l’idiot…). De même la romancière par des allusions précises à l’Histoire inscrit le roman dans une forme de contemporanéité qu’elle transfigure par l’onirisme (la guerre civile espagnole, les commentaires de Miguel l’ami d’Inès, celui qui a été le père éducateur de toutes ses filles, la première guerre mondiale -l’histoire du soldat de Stravinsky- dont s’inspire le film tourné dans le village).
Les Roses fauves ! Un titre oxymore ? Roses qui se nourrissent des désirs qu’elles insufflent, elles seront lubriques. Elles envahiront ces jardins dès que palpitera l’appel du désir ! Et le corps -dont la thématique est très prégnante : corps révélé, approprié, par sa nudité exhibée et assumée- est exalté en des passages d’une puissance sensuelle incontestée. Roses vénéneuses et scélérates aussi. Celles qui puent le foutre et la mort disait nauséeux le père d’Inès ; propos repris à l’identique par l’auteure... Roses dont le parfum âcre qui tient de la fleur et du fauve est chargé de minuscules épines qui déchirent les poumons…
C’est que ces roses sont au carrefour des vivants et des morts là où elles se gorgent de sang et de désir
-
Valencia Palace de Annie Perreault (éditions Le Nouvel Attila)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Éblouissant ce premier roman d’Annie Perreault tant par sa construction que par l’ambition de son sujet. Une scène originelle -Claire n’a pas retenu la femme qui, après lui avoir confié son sac, s’est jetée dans le vide-, scène vécue au Valencia Palace en cet été 2009, et l’hôtel comme l’épicentre d’un séisme intérieur... Le découpage du texte -qui parfois s’apparente à un storyboard – obéit à la dynamique déconstruction/reconstruction celle qui précisément anime le personnage principal en proie à un sentiment irrépressible de culpabilité. Les distorsions temporelles (flash back et montages parallèles) les jeux d’instances narratives la gémellité, les dédoublements, le flux ininterrompu de certaines phrases créent un étrange malaise dans un huis clos intérieur où sont conviées beauté et terreur.
Comme pour Moderato cantabile, de Marguerite Duras, l’évidence d’un événement extérieur -dans les deux cas la mort d’une femme- s’oppose (ou se superpose) par antiphrase à un univers mental. Et c’est bien le contraste entre la précision quasi clinique -dont témoignent titres et intertitres à valeur programmatique et certaines descriptions- et le flou l’irréalité l’étrange évoqués, le mélange de réalisme et de fantastique, la superposition de deux pôles, l’éloquence de ce qui est tu et le passé revisité, qui frappent d’emblée à la lecture de Valencia Palace. Un emmêlement qu’illustre la photo de couverture (image tirée de by the sea) de Maïa Flore : une femme vue de dos sur une plage, les bras tendus se confondant avec la ligne d’horizon et pourtant on ne peut identifier avec netteté horizontalité et verticalité : sable ou rempart/rambarde ? Appel du large ou peur de la chute ?
Effets spéculaires et lignes de fuite traversent ainsi de part en part le récit. Enchevêtrement de va-et-vient qui se télescopent. Et les distorsions temporelles -la collision 2015 -2025, le va-et-vient entre le moment présent 2015 et/ou 2025 et le passé proche (été 2009) ou plus lointain- participent de cette démarche de déflagration. Scènes qui se font écho (avec reprise de titres identiques) entre ce 9 août 2009 où Claire -alors en vacances avec son mari Jean et ses deux enfants Laure et Léon à l’hôtel Valencia Palace, assiste – indifférente?- au suicide d’une femme et cet été 2015 où elle revient, seule, sur les traces de...(elle ne peut pas savoir que je suis la femme qui en a laissé mourir une autre) Et ce retour coïncide en un audacieux montage parallèle avec le marathon auquel participe sa fille Laure en 2025, à Valence. Les deux déambulations certes éloignées dans le temps, se rejoignent en un parcours initiatique dont les étapes sont scandées pour l’une par ses enquêtes, ses prises de conscience et ses rencontres et pour l’autre par les kilomètres qui défilent ; déambulations à la fois physiques et mentales qui progressivement dessinent un portrait de la mère où le même est évoqué et ressenti selon deux points de vue. Claire n’est-elle pas pour sa fille cette mère irréelle (en italique dans le texte) qui « flotte dans son rayon de lumière, figée dans un paysage d’automne avec son air de mystère… » ?
Annie Perreault joue sur la gémellité, la duplication, la surimpression qu’elle décline ad libitum : les deux séjours à Valence, Claire et la femme de Valence, Claire et sa fille, Claire personnage de roman et auteur du même roman (réédition de « trois jours à Valence ») ; Claire scénariste d’un film « je suis ici pour écrire un scénario... la femme est blonde et blessée, le ciel est brumeux, c’est un huis clos étouffant sur le toit d’un hôtel, le film est construit sur un malaise, une inquiétude, un mystère, on ne sait pas qui est cette femme, et on ne le saura pas, à la fin, elle se jette du haut du toit, on ne sait pas pourquoi » dira-t-elle à Juan Carlos en présence de Manuel en 2015 ; Claire elle-même a l’air d’une femme étrange inquiétante : elle peut changer d’identité et de couleur de cheveux comme dans le film Vertigo.
Jeu sur les instances narratives aussi où le pronom « elle » serait comme le double d’un je inarticulé, alors que le je de Laure qui prend le relais s’éploie en longues phrases accumulatives (une par kilomètre parcouru) où la ponctuation est celle du flux de la pensée, des souvenirs et de la pulsation du coeur qui bat à l’écoute de son propre corps.Oui être à l’écoute de son propre corps ! c’est un autre questionnement de Valencia Palace. La romancière qui vit à Montréal, est marathonienne à ses heures (dit la couverture). Ce n’est donc pas pur hasard si Laure -dans le sillage de sa mère – pratique la course à pied. Un sport qui exige souffle et concentration ; un sport qui met à l’épreuve les facultés d’endurance (Laure sait qu’elle n’a jamais couru au-delà de 30km et pourtant…) ; sport qui comme le lâcher prise peut être si bénéfique ! Claire court en ligne droite en longeant la mer, et peu à peu son corps se déleste de ses raideurs et sa mâchoire ramollit. Au km 33 Laure sent la mollesse des bras, du ciment dans les jambes...mais elle va tenter d’oublier la raideur ...avant d’assister au surgissement d’une force inouïe !
Suivre la trace de la femme suicidée tout en traquant son propre réel, n’était-ce pas le pré-texte à une quête existentielle ?
Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. C’est le voyage qui vous fait ou vous défait (Nicolas Bouvier L’Usage du monde )
-
"La leçon de ténèbres" de Léonor de Récondo (Stock ma nuit au musée)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
L’auteur a donné rendez-vous à Doménikos Theotokopoulos dit El Greco (1541-1614) dans sa maison à Tolède, une maison devenue Musée (Museo del Greco). De 23h15 à l’aube en ce samedi de juin à la touffeur caniculaire, nous allons suivre celle qui se prépare et se pare avec volupté pour ce nouvel hyménée, la rencontre amoureuse avecDoménikos mi amor.
Si le titre Leçon de ténèbres renvoie à un genre musical français du XVII° sièclequi accompagnait les offices des ténèbres pour voix et basse continue, le récit de cette nuit au musée(exercice proposé par les éditions Stock) fera entendre plusieurs voix lors d’une double déambulation : les fragments étoilés de souvenirs personnels épousant le parcours du Greco depuis son île natale jusqu’à Tolède en passant par Venise et Rome. Et l’intensité quasi mystique des gestes des pensées des deux « amants » va vibrer d’une majesté sensuelle et musicale
Faire sortir le peintre de son « obscurité » par-delà les siècles qui les séparent, convoquer en ce lieu de mémoire (le musée de Tolède) les « fantômes » qui habitent le cœur et les pensées de « l’amante » -et la figure du père s’impose dans sa singularité- les relier à l’univers du peintre dans une confondante unité, n’est-ce pas la singularité de cette immersion nocturne qui embrase le corps et l’esprit ?
La structure narrative s’éploie en trois mouvements (miraculum mundi, yermo, lux aeterna) et fait éclater (malgré l’apparente linéarité du double parcours) points de vue et chronologie pour mieux les enchâsser dans un montage alterné jusqu’à la fusion finale, par-delà (ou au-delà de) l’espace et le temps
De même la romancière fait alterner récit dialogues et poésie. En interpellant Doménikos en le tutoyant en le faisant vivre à différents âges de sa vie et en différents lieux, en le célébrant, elle se place sous l’égide de Jean de la Croix (cité en exergue) auquel elle emprunte pour le faire sien le thème de l’amour impatient tout en renouvelant le lyrisme mystique des poèmes de la nuit. Les caresses musicales (la narratrice a emporté son violon, instrument de séduction…) vont à la rencontre du peintre aimé. Dans cette nuit sans fin dans cette lente attente de toi, Doménikos, il m’a fallu des heures de préparation, de pérégrinations, de prières, pour qu’advienne ce nocturne peu avant l’aube, pour que surgisse mon unique leçon de ténèbres
La leçon de ténèbresou le dialogue entre les vivants et les morts. Doménikos a posé ses doigts sur la pierre que la Vierge aurait foulée en descendant imposer la chasuble à saint Ildephonse et des siècles plus tard Léonor de Récondo caresse la pierre Doménikos rejoins-moi. Tu es ma prière. En contemplant le tableaul’Expolio ne se sent-elle pas priseau piège/ du croisement de son regard/ avec le geste impudent du pinceau de l’artiste ?
Dialogue entre les arts aussi: Doménikos et Francesco cheminant sur les routes de Castille rappellent Don Quichotte et Sancho Panza ; età l’instar du fameux hidalgo de la Mancha, Doménikos se battra contre des moulins à vent. Dans l’attente du peintre aimé la narratrice joue du violon car « il faut que les sons galopent jusqu’à toi transpercent le temps »
Dialogue et filiation enfin. Dans son musée imaginaire la romancière établit des parallèles entre Le Greco, Egon Schiele et le Picasso de la période bleue - un fil visible certes mais surtout celui invisible d’une réalisation portée au plus strict dénuement.Un art qui transcende les techniques les méthodes les supports. De même qu’en évoquant la peinture de son père Félix de Récondo -parfaite descendance du firmament espagnol - elle avait été frappée par les similitudes avec les univers de Bacon Rebeyrolle Dado[1]
La filiation c’est aussi l’éducation du regard. Doménikos explique à son fils Jorge Manuel le rouge des velours des soies l’acuité des portraits « peindre ce que tu as attrapé dans le filet de tes yeux en faisant fi des apparences,des ors, des fraises en dentelle, des célébrations ; regarde tout ce qui est à ta portée mais n’en restitue que l’essentiel. Léonor de Récondo, très jeune, a appris la discipline artistique et se rappelle certaines conversations avec son père sur la création et l’apprentissage. Et voici que résonne son credo scandé par l’anaphore « je crois » « je crois à l’éducation du regard qui comprend l’élaboration d’une réflexion. Je crois à la connaissance dans le temps nécessaire à la création d’un présent qui ait un sens, un présent qui embrasse, contienne les routes traversées et celles à venir, même si nous foulons inlassablement les territoires de ceux qui nous ont précédés, même s’il nous plaît d’imaginer que nous les réinventons. »
Alors que Doménikos âgé de 73 ans (1614) vient de capter dans l’instant ultime le regard de la femme aimée Ariana, couché dans son sourire il laisse le ciel s’engouffrer sous sa paupière et « meurt de ne pas mourir. »
Il est désormais prêt pour l’enlacement et le baiser suprêmes dans le jardin du musée de Tolède. Tu souffles sur mes paupières faisant voler / en éclats mes larmes. / Et tu lèches mes éclats [...] C’est notre baiser / à la lisière du temps / celui du jardin originel Notre baiser, / dans la sauvagerie de notre amour / le flamboiement de notre désir
La lumière, malgré la nuit
[1]Une plaquette, avec les portraits de Mohror, éditée dans les années 80 90 préfacée par Michel Faucher le fait d’ailleurs figurer aux côtés de Rocher, Gillet, Rebeyrolle, Velickovic entre autres
-
« Une fois (et peut-être une autre) » de Kostis Maloùtas (Editions Do)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit du grec par Nicolas Pallier
Premier roman de Kostis Maloutas (né en 1984 à Athènes) une fois (et peut-être une autre) frappe par un mélange de critique assassine -celle du monde littéraire,- et de dérision… Le point de départ ? Deux auteurs un Allemand et un Uruguayen ont écrit au même moment, sans se concerter, un livre identique « une fois (et peut-être une autre) ». Deux critiques essayistes -chacun dans son pays respectif- en ont fait une analyse qui se veut plus ou moins exhaustive ; identique !! Deux éditeurs vont profiter de ce hasard en le transformant en « événement littéraire » par un battage médiatique sans précédent…
Le romancier entraîne son lecteur dans un jeu de miroirs en jouant avec le principe de gémellité, de duplication qu’il décline ad libitum. Il est lui-même tout à la fois auteur lecteur critique dont il parodie les « tics » et les « défauts ». Crise de la littérature ? De l’inspiration de la création ? Assurément. Et dans un style où les mots vont se jouer des maux…
À situation absurde traitement absurde. Et pourtant l’incipit laisse entrevoir une approche plus sereine et logique : la coïncidence initiale serait due à cette « imprévisibilité » qui est au cœur même de la « réalité ». Gageons qu’il ne s’agit que de faux semblant. Ne serait-ce pas plutôt l’illustration -certes loufoque- d’un constat amer : il n’y a pas d’écrivain original, il n’y a pas de thème original ; on ne crée pas ex nihilo. Tout est dit et l’on vient trop tard !
Le Sec, personnage principal du roman « une fois (et peut-être une autre) » écrit par Wim Wertmayer (publié le 7 novembre 1999 aux éditions Weisswald) n’a pas d’épaisseur... L’intrigue se déroule « dans un présent indéterminé » dans une ville « incertaine et impersonnelle ». L’auteur prend un malin plaisir à « décortiquer » ce roman en soulignant les « ratés », les clins d’œil faciles, les astuces narratives éculées ou prétendument novatrices (ainsi la synchronisation entre texte et image reproduite page 15 et support à l’illustration de couverture). Or le travail sur des œuvres passées pour « y retrouver les traces de structures formes ou contraintes » n’était-il pas inscrit dans la charte de l’Oulipo ? Et la récurrence du double - le nodule dans le cou comme un autre « je » avorté, les deux dessins en miroir, les deux aéroports identiques, le personnage féminin de la Petite, sœur de Le Sec et la petite de la nouvelle, récit dans le récit où guerroient deux rois, le client qui achète deux livres dont les couvertures se ressemblent- n’illustre-t-elle pas mises en abyme et complexité apparente d’un dispositif ?? Kostis Maloutis est le lecteur critique de Wim Wertmayer tout en prenant à partie le lecteur du présent volume par des mises en garde mais aussi des procédés d’attente (empruntés d’ailleurs à l’auteur qu’il est censé critiquer). Ainsi en est-il de ces nombreuses parenthèses -explicatives ou non dont celle du titre- et de ces digressions. Point faible du romancier ? Ne le revendique-t-il pas plutôt comme élément d’une stratégie d’auto-dérision ? Ainsi quand il écrit page 48 « mais reprenons le fil du récit à l’endroit où nous l’avions laissé » c’est-à-dire page 9…
Après avoir « désossé » ce roman -sorte de métalangage-, il s’attaque au double uruguayen Joaquin Chiellini (édité chez Libros de Papel Transparente) adoptant cette fois le point de vue du critique Guillermo Hurtado et de l’éditeur Rodrigo Caiman (Kostis Maloutas romancier, double d’un critique de critique littéraire). L’appât du gain va présider à la réédition du roman de Joaquim Chiellini (la première avait fait un flop) et de la version revue et corrigée de la critique. L’assomption dans la complexité Kostis Maloutas la réserve pour la rencontre d’abord à Montevideo (puis en écho à Francfort) de tous (enfin presque) les protagonistes : les deux écrivains Chiellini Wertmayer, les deux critiques Hurtado Bichsel et les deux éditeurs Rodrigo Dieter ; et il conviendrait d’ajouter les traducteurs (doubles de Nicolas Pallier qui a traduit du grec le roman que l’on est en train de lire ?) et tous ces universitaires qui ne sont pas avares de gloses surtout quand il est question de « bizarrerie télépathique ». Les deux éditeurs s’entendent à merveille pour faire fructifier ce « hasard ». Pince sans rire, le romancier évoque avec la distance de la componction, les « affres » de la traduction (de l’allemand en uruguayen et vice versa... alors qu’il s’agissait du même, le jumeau…)
Oui nous sommes embarqués dans les dédales du battage médiatique, tout comme le romancier joue avec les circonvolutions et les circonlocutions (il nous tend des pièges, fait semblant de les déjouer).
Et qu’en est-il du lecteur de la fiction ? c’est Sabine Kreutz Müller la compagne de l’éditeur allemand Dieter Moogerfooger qui s’interroge sur l’inanité des procédés narratifs choisis par les deux écrivains ; elle les attaque frontalement « pourquoi nous infliger vos aspirations ridicules tout ce qui vous fait espérer que votre œuvre est à la hauteur de celles que vous admirez…[…] Vous avez peur qu’on vous accuse d’écrire de manière simpliste ou est-ce parce que vous êtes convaincus que ce qui est difficile et biscornu ce qui interpelle le lecteur est automatiquement d’avant-garde » Lectrice insatisfaite ? Mais est-ce tout simplement envisageable quand on sait qu’elle ne lit jamais… ???
L’ultime astuce (ou plutôt antépénultième car il y aura in fine un rebondissement, évoqué en montage parallèle) : les six ont décidé de rédiger ensemble un texte qui serait comme la genèse de cette « histoire » …
Or ce livre existe déjà !!!
Nous sommes en train de le lire
une fois (et peut-être une autre) se donne à lire comme un « jeu » littéraire (Kostis Maloùtas rend ainsi hommage à ses devanciers) ; un exercice qui avec humour et jubilation soulève des problèmes éminemment littéraires (le romancier et l’inspiration, la relation auteur/éditeur, la relation auteur/lecteur, le rôle de la critique dite littéraire, la marchandisation du livre)
On regrettera toutefois les tournures approximatives et/ou incorrectes de la traduction ; elles parasitent voire paralysent le simple plaisir de lire.
-
"Kree" de Manuela Draeger (Éditions de l’Olivier)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Par le sortilège d’une narration explosée dans l’espace-temps de la nuit sans étoiles, Manuela Draeger, une des Voix du post-exotisme, fait « revivre » le « destin » d’une sœur du désastre, Kree Toronto. Femme guerrière, experte en arts martiaux, elle n’aura cessé d’errer -sous le ciel épais comme du brai- ; elle aura survécu aux guerres fratricides à la grande guerre noire. Une errance ponctuée de réminiscences, de rencontres, de pauses faussement salutaires, de scènes macabres, de chants et prières, mais empreinte de tendresse et d’humour ! Nous sommes dans un monde post exotique celui de la décomposition, de l’espace charbonneux, nous sommes simultanément ici et là, dans un avant et un après, entre vivants et morts, réel et rêve, sondant une mémoire historique collective (rêves avortés de l’égalitarisme) qui rejoint précisément la mémoire de l’ailleurs, si familière aux lecteurs d’Antoine Volodine.
La narration -où se mêlent réalisme cru et merveilleux, tragique et burlesque, humour et autodérision- se déploie en sept chapitres à l’architecture particulière. Si chacun a sa tonalité propre dans l’évocation d’une étape singulière ou la manière de « vivre » cette étape, certains se font écho (III et V) – choix formels, évocation du passé, celui de Kree et de Griz- et l’atmosphère est souvent glauque et irrespirable dans la marche vers... L’auteure fait alterner récit -longs paragraphes descriptifs sur le « quotidien » de Kree (IV), et dialogues au parler mutilé, instantanés -découpage typographique- en harmonie avec les bribes du savoir, de la mémoire et réflexions plus générales sur la création tout en jouant avec des collisions de temporalités. Cette alternance va de pair avec le rythme qui scande errances et pauses, le temps qui s’étire ou se contracte -dans la fixité d’un présent réinventé. Un « balancement » annoncé dès l’incipit ! Un souffle épique souvent comme dans les chansons de geste ! La circularité -les deux morts de Kree, au début et à la toute fin- et les nombreuses récurrences (rites, funérailles terrestres et célestes, obstructions, les trois disparitions, la gémellité Myriam/Kree, Gomchen/Grizy, la présence d’araignées, légendes colportées sur les oeufs et leur concrétisation) n’illustrent-ils pas la répétition d’un même naufrage celui de l’existence ? Ensemble on est la même famille de cauchemar et de malheur. On est tous ensemble des frères et des sœurs de désastre.
La scène inaugurale frappe par sa théâtralisation et ses effets cinégéniques : l’auteure comme en surplomb ou en frontal, dirige ses acteurs, « deux personnages immobiles un dialogue laborieux, un décor en bois, une lumière avare avec des effets d’ombre » Kree est venue venger la mort de sa chienne Loka outrageusement mangée par les frères Godron ; (un couple qui peut rappeler Laurel et Hardy...) Art martial et fleur d’acier sanguinolente !! Mais un coup de feu fatal !! Dès lors nous sommes projetés dans un monde post mortem… où Kree était d’ailleurs attendue…Comment s’en étonner ? le bardo (les araignées ont elles aussi leur bardo !!..) ou plutôt les bardos ne sont-ils pas appelés à se répéter dans des réincarnations ratées, contraignant à marcher sans cesse dans « l’enfilade des espaces noirs » ? Le risque encouru ? Plonger dans la dépression et l’asthénie est un des pires dangers contre quoi nul ne peut se prémunir... L’esprit se décourage puis s’éteint . Et pourtant malgré les aurores étranges, les pluies acides, l’humidité permanente, les coups de vent porteurs de miasmes les « conditions de vie sont acceptables pour les rares organismes qui ont franchi la dévastation »…
Le cas de Griz Uttikuma (l’homme à la casquette de marinier, au crâne blessé) illustre avec réalisme, fantaisie et onirisme le processus de « re-naissance ». En témoigne le chapitre V qui lui est consacré : à l’alternance entre les pronoms « tu » (dédoublement ?) « vous » (Griz et Smoura) et « il » (distanciation ?), correspondent la récurrence d’objets et d’animaux symboliques, l’action hallucinatoire, et l’évidence solaire de l’Amour... Après 49 jours -ou 49 mois voire 49 années-, Griz va quitter la « gangue » avec sa belle Eurydice chagallienne Smoura Tigrit (illuminés par une violente clarté lumineuse). Il sort de la coquille, des profondeurs des fosses. Il éclot... en adulte... Mais il sera seul ! Et son premier jour « d’existence » implore le dernier (celui des retrouvailles avec l’aimée !!). Or, nous l’avions découvert au chapitre précédent en déserteur rééducable confié à la vigilance de Kree, déléguée ouvrière et paysanne, chargée de surveiller ses progrès en conscience égalitariste. A noter ici que la séance à la salle des fêtes de la Maison des Mendiants vaut son pesant de cynisme narquois ! (IV,5)
En écho au chapitre V, le chapitre III où le passé de Kree est restitué sous forme d’instantanés, de flashes -aussi éclatés que la chronologie – offre un échantillon de l’univers post-exotique : noirceur permanente du ciel, stade agonique de l’humanité « le monde est si oniriquement ténébreux que plus personne n’établit de différence entre la nuit du jour et la nuit des rêves ». Élevée par Golgolian, initiée très jeune à la lecture à l’écriture et aux arts martiaux, Kree participera à des opérations de commando ; elle aura connu des épisodes de barbarie violente, aura tué, vaincu ses adversaires, triomphé d’obstacles. Amazone hostile à l’accouplement, Kree, une héroïne digne d’une épopée ? Or « bien qu’elle fasse partie des gens qui ont duré le plus longtemps aucune légende n’accompagne sa figure ». Pourquoi ?
Comment s’opère la « transmission » ? Dans une « société » d’après la catastrophe, celle des mendiants terribles, (thuriféraires du polpotisme), qui a confisqué jusqu’à l’identité de chacun et aboli toute culture de la mémoire ? Manuela Draeger va inventer des modes de transmission. Des oiseaux géants tentent de repeupler le monde avec des créatures qu’ils fécondent au milieu des cadavres. La « tente tremblante » que le Tibétain Gomchen installe chez Myriam Agazaki une ybüre (sorcière guérisseuse chamane) permet de communiquer avec les morts (de remonter le temps ?). Il en va de même avec les herbes « magiques ». Les épingles dans le crâne sont comme les stigmates de traumas plus ou moins anciens. Kree en cisaillant les grillages retrouve à 40 ans des gestes de son enfance martiale (mémoire musculaire). Une recette de pemmican et c’est l’image du soldat bachbak son « violeur ». Mémoire individuelle ! Moins des remembrances que des images ! Mémoire collective ? La règle est de « taire l’essentiel de notre passé ». On est prêt à reconstruire des histoires et sa propre histoire. Si les survivants ont « abaissé sur leurs souvenirs un rideau de fer », c’est pour ne pas tomber dans la folie et le marasme... et Kree comme presque tous les survivants situe le passé dans un autrefois sans repères et sans importance ; alors que le présentest une « simple répétition » de l’horreur des existences précédentes.
Quand on « nous oblige à y revenir [...] nous racontons une autre vie que la nôtre, nous inventons un autre enfer que celui d’où nous nous sommes miraculeusement extirpés. Nous trempons à contrecoeur dans ces romans afin que rien ou presque rien d’insoutenable ne brûle à nouveau en nous et nous détruise. C’est nous-mêmes que nous mystifions » Le pronom « nous » qui inclut Manuela (auteure et personnage.) évoque tout autant la pluralité des voix qu’un déchirement individuel et collectif.
Mystification assumée !
La Voix de Manuela aura inscrit dans une mémoire partagée, le « destin » d’une amazone, amnésique, arachnophobe, astigmate. Images hallucinées aux échos amplifiés ou amortis par leur passage dans les espaces noirs.
Rêve de suie ?
« Le pessimisme le plus lugubre et le désastre absolu sont une pâte inerte avec quoi on peut façonner des objets extrêmement lumineux » (Antoine Volodine)
-
"Francis Rissin" de Martin Mongin (éditions Tusitala)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
De qui Francis Rissin serait-il le nom ? Ce personnage de fiction -qui échappe d’ailleurs à son auteur...- est censé incarner le Sauveur, celui qui délivrera une France qui va mal, écœurée par des décenniesde compromis et compromissions… Au tout début un nom ; un nom de 13 lettres qui progressivement s’incarne, prend consistance, tout en se dérobant ! Le lecteur est invité à participer à une « traque » -qui est aussi celle d’un inconscient collectif- entraîné dans un mouvement labyrinthique, scandé par onze approches aux registres et styles différents. Ce roman -fable politique où se mêlent gravité et humour- est aussi un questionnement sur l’acte de créer, sur l’objet littéraire. Martin Mongin serait-il le rhapsode des temps modernes ? Francis Rissin notre « rédempteur » ?
Ce roman est composé de onze chapitres -dont les titres sont censés se référer à des sources vérifiables- assez courts pour ne pas anesthésier la spécificité de chaque « genre » et de chaque style : on passe ainsi d’une conférence universitaire à une enquête policière, du journal intime à des rapports « officiels », de l’autobiographie à des compte-rendus hospitaliers de la confession à des quêtes enquêtes contre-enquêtes, et un chapitre contient même le script d’un long métrage... La structure interne obéit aussi à un double mouvement -dont le chapitre 6 serait le pivot- les cinq premierschapitres approcheraient le nom, jusqu’au chapitre six, le journal intime où on est au plus près du personnage. Les cinq chapitres suivants, c’est le mouvement inverse, il se délite (propos de l’auteur). Et d’un mouvement à l’autre se dessinent des effets spéculaires, même si les « onze pièces fonctionnent comme autant de plans de réalité distincts » (Avertissement)
Convoquant des genres et registres divers, l’auteur s’en s’approprie les codes tout en les parodiant !! (roman autobiographique et roman d’initiation par exemple). Autant d’approches (littéraire, politique, sociale et autres) d’un personnage aussi imprévisible qu’insaisissable. Car Francis Rissin c’est un clone (multiplication des affiches et don d’ubiquité) c’est un criminel (sans état d’âme il procède à l’élimination de qui entrave son ascension..) c’est un chef d’état (élu grâce à une manipulation des esprits que relaie une presse complaisante) c’est un beauf !!Complice, le lecteur assiste à des séquences hallucinées (on retiendra le vernissage à Beaubourg) ; passager clandestin, il accompagne Sirac au volant de sa Laguna sillonnant toute la France rurale (dont le romancier se fait le peintre). Et cela sur un fond politique précis, vérifiable: émeutes grèves. Un pays malade. Un pays en attente d’un homme providentiel qui le délivrerait de la chienlit ? Ou du moins s’agit-il des velléités de ceux qui attendent un « homme de poigne » un chef qui a la trique et qui… rétablirait la peine de mort par exemple...
Cet « objet » littéraire peu convenu se mue en une vision futuriste et fantastique - ancrée dans le Réel, et qui refuserait l’allégeance sans faille à la religion- ;et ce, grâce à la liberté de ton, au sens de l’image et du rythme, à la variété des registres et à l’omniprésence d’un humour froid noir ou grinçant. Convoquant des personnages bien identifiés, -qui ont réellement existé ou qui sont encore vivants et qui nous sont plus ou moins familiers (architectes, romanciers, peintres, artistes, hommes politiques)- l’auteur « expérimente » aussi -dans le sillage de Laurent Binet?- les relations de la fiction à la réalité, du récit à l’interprétation par une subversion des codes et des genres. Décontextualiser le factuel et le (re)contextualiser dans (et par) la fiction ?
« La littérature commence avec Homère et toute grande œuvre est soit une Iliade soit une Odyssée » cette phrase de Raymond Queneau que rappelle Catherine Joule dans son séminaire du 3 septembre (chapitre 1) permet au romancier de « situer » Francis Rissin (ou du moins le pré- texte Approche de Francis Rissin) dans une « zone » intermédiaire « intervallaire, indécise et nébuleuse ». Si le personnage n’existe pas, les tentatives littéraires – polar, fantastique, épopée, roman d’initiation, roman politique – seraient-elles, elles aussi, frappées d’inanité ? Et que devient le rapport auteur/lecteur ? (Un pacte loin d’être rompu d’ailleurs, au contraire). Lecteur apostrophé, confident et témoin de Francis Rissin (de ses avatars) pris au piège de la création ? … Lecteur à même de signaler ici et là des longueurs et/ou des redondances inutiles (tout comme Terrast qui, d’un ton docte et solennel imitant les évangélistes, s’excuse de ses digressions…).
Remonter vers ce qui tisse le processus du geste : « reconstituer la scène inaugurale, moment où le texte a été élaboré : cette démarche revendiquée par Catherine Joule, cette universitaire, que l’on retrouvera « convertie » en psy au chapitre 8, est aussi celle de Terrast (chapitre 11) alias Sergent (chapitre 10) alias ??D’abord il n’y avait rien et l’instant d’après il était là. Miracle de la Création ! Même si la vie de Francis Rissin est un livre qui n’existe pas, une épopée qui n’ pas eu lieu, le roman de Martin Mongin -qui en rend compte- est truffé de références à la mythologie grecque -ses personnages sont comme les descendants des Ajax Achille Ulysse... Terrast n’avoue-t-il pas que non seulement les livres l’ont sauvé (lui et ses potes, au Centre de Florac) mais qu’Homère est devenu leur seul maître...
Présence prégnante d’un être qui existe en se dérobant ou qui n’existe pas, créé par un auteur contorsionniste du langage qui adopte tous les registres, (réalisme cru, poésie, fantastique), mélange les genres (baroque, épique) parodie la Bible : Oui Francis Rissin est une œuvre ludique à l’extravagance maîtrisée
Francis Rissin : une œuvre prémonitoire ??
« Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui pense à la France ? » Cette question, le personnage, venimeux, l’adresse au Sénat et à l’Assemblée nationale, au moment où il est prêt à donner un grand coup de balai dans un pays transformé en hôtel de passe VIP - Extraite de son (prétendu) journal (chapitre 6) et citée en exergue, ne résonne-t-elle pas comme une admonition ou du moins un avertissement ?
-
"Ici n'est plus ici" de Tommy ORANGE (Editions Albin Michel)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Traduit de l'américain par Stéphane Roques
Éblouissant, ce premier roman de Tommy Orange (né en 1982 à Oakland) tant par sa construction -un chœur de douze voix, des destins individuels qui convergent dans le grand rassemblement du pow-wow-, que par les ressources de sa langue, - qui mêle plusieurs registres - et l'ambition de son sujet -la quête d’identité et d’appartenance. Une geste, celle des Indiens urbains d’Oakland, comme support à une méditation et à une revendication.
Le lecteur est invité, avant d’entrer dans la fiction, à se rappeler (ou tout simplement découvrir) ce que fut l’existence des Indiens : massacres, génocide, récupération, euphémisation, clichés... C’est le prologue (auquel fera écho le chapitre « entracte » dans la deuxième partie Réclamation) Oui « des confins du nord du Canada au nord de l’Alaska jusqu’à la pointe de l’Amérique du Sud les Indiens ont été éliminés puis réduits à l’état de créatures à plumes » « Nous amener en ville était l’étape finale de notre assimilation, […] l’achèvement de cinq cents ans de campagne génocidaire. La ville nous a renouvelés… Nous nous la sommes appropriée.
Dès lors le romancier peut donner la parole à des Indiens urbains. Écoutons-les !
Voici des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes. À travers leurs témoignages d’abord juxtaposés, individualisés, le lecteur établira bien vite des connections, liens de parenté ou de connivence. Si la diversité des instances narratives (« je » « il » ou encore « tu » pour Thomas Frank), des âges et des expériences vécues, fait du roman une sorte d’épopée polyphonique, la diversitén’estqu’apparente. Fragmentation, morcellement pour mieux appréhender l’humain et faire des événements relatés (nombreux flash-back) le lieu où se rencontrent des destinées. Tous les personnages du roman semblent porter des stigmates liés à la pauvreté, l’alcool, le chômage, l’abandon, le suicide, la prison. Et ce n’est pas pur hasard si Tony Loneman, 21 ans, est le premier à prendre la parole : son visage élimé, le Drome, est le signe du « syndrome d’alcoolisation fœtale » et ce qu’il raconte peut se lire comme une mise en abyme : préparation du pow-wow, bienveillance d’une grand-mère, croyance en la « boîte-médecine », importance du regard (qui sera repris en leitmotiv et décliné dans toutes ses connotations (tenter de voir autre chose que ce dont on a affublé les Indiens) Les gens « détournent les yeux quand ils voient que je vois qu’ils me voient ». Pour un Blanc ne peut être Indien que celui qui porte des plumes (et à un moment Orvil, petit-fils de Jacquie, est fier de se parer du costume pour interpréter une « danse indienne » il a répété en regardant des danses sur YouTube, mais en cachette car sa grand tante Opale lui a dit et répété « tu es Indien parce que tu es Indien, parce que tu es Indien….Ce premier chapitre est aussi prélude, annonciateur de la tragédie ; Tony va participer avec Octavio et d’autres comparses à un braquage au pow-wow (or une balle qui transperce et fait un trou, ne représente-t-elle pas, par métonymie, toutes ces balles qui ont parcouru des années…pour exterminer tout un peuple, une mort programmée). Le pow-wow, c'est sur cette scène, à la manière du théâtre antique, que va se jouer la tragédie, condensé d'une violence engrangée depuis deux siècles et figurant la mort programmée d'un peuple
Dene Oxendene le deuxième à prendre la parole, n’est-il pas le « double » du romancier ? Ou du moins son porte-parole ? (même si de l’aveu de l’auteur chaque personnage est une parcelle de lui-même). Membre des tribus Cheyenne et Arapaho, il veut « attester de l’histoire de certains Indiens d’Oakland, collecter leurs témoignages, Il est convaincu que les histoires individuelles ne sont pas pitoyables, mais pleines d’une vraie passion, d’une rage. Et c’est précisément cette énergie, cette rage qui anime les différents personnages du roman quand ils sont en butte à leur passé qui les a cabossés ou confrontés à leur présent, dans leur besoin irrépressible de reconnaissance. Emmurés dans l’Histoire et l’Histoire emmurée en eux (citation de Baldwin). Thomas Frank résume une situation douloureuse partagée par les Indiens au sang mêlé « le fardeau que tu portes vient du fait que tu es né à Oakland. Un fardeau de béton, lourd d’un seul côté, la moitié qui n’est pas blanche...Tu viens d’un peuple qui a volé, encore et encore et encore. Et d’un peuple qui a été volé. Quand tu prenais un bain tu regardais tes bras cuivrés sur tes jambes blanches et tu te demandais comment ils pouvaient être attachés au même corps »
Dans la dernière partie du roman, le rythme s’accélère ; tous les personnages (avec lesquels on a sympathisé et dont on connaît les motivations) sont réunis au Coliseum pour le pow-wow. Les chapitres de plus en plus courts font se succéder de façon vertigineuse les différents points de vue ; la phrase elle-même se met à crépiter comme si elle imitait le tracé des balles ou une caméra qui virevolte. Les plans et angles de vue en un fabuleux montage créent un final époustouflant où la parole semble survivre au corps qui agonise…
Le titre de ce premier roman est emprunté à Gertrud Stein (Autobiographie d’Alice Toklas) : There is no there, there C’est la disparition de l’Oakland rural de son enfance ! Dene qui n’a pas lu Gertrud Stein en dehors de cette citation sait que pour les autochtones de ce pays partout aux Amériques se sont développés sur une terre ancestrale enfouie le verre le béton le fer l’acier, une mémoire ensevelie et irrécupérable. Il n’y a pas de là, là : ici n’est plus ici...
Or, Il ne faut jamais s’abstenir de raconter notre histoire et personne n’est trop jeune pour l’entendre. Nous sommes là à cause d’un mensonge, avait confié la mère à sa jeune enfant Opale alors qu’elles étaient sur l’île d’Alcatraz - occupée par les Amérindiens de 1969 à 1971
Ici n’est plus ici un flux mémoriel choral et syncopé, que ponctuent d’abondantes références littéraires
Ici n’est plus ici un roman engagé et décapant, noir et lumineux
-
"Aires" de Marcus Malte (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Lundi 6 août. Chaleur caniculaire. Nous embarquons à bord de différents véhicules. On the road again. L’habitacle de la voiture devient par métaphore celui des pensées. Les voix intérieures dialoguent avec le crépitement des infos, des chansons et des slogans publicitaires. Et voici qu’en disant le monde – celui d’une ère censée être révolue...- l’auteur le déroule, le déploie, ancre l’Histoire dans les histoires -ou l’inverse- car c’est bien d’un chassé croisé multiforme et/ou de télescopage qu’il s’agit dans cet « état des lieux »… Tout comme il a fait s’enchevêtrer, se repousser, se croiser, des micro histoires d’abord parallèles.
Une écriture polyphonique, le recours à toutes les ressources du langage et de la typographie, des enchâssements de récits avec mises en abyme, un mélange d’humour, de cynisme et d’amertume : tel se donne à lire, entendre Aires le roman de Marcus Malte
Le roman s’ouvre sur un prologue à la police spécifique et au style déroutant (ex cybero sum). Prologue auquel répondra en écho un épilogue. Un narrateur -double de l’auteur- professeur de l’ère nouvelle s’adresse à des aspirants graduates juvides et nubies Il explique la genèse de son projet : comprendre sur quel tas de fumier a poussé la rose, et annonce ce qui va apparaître sur le portail relater dans le dialecte originel une seule journée une longue séquence du premier cent du troisième mil ante reset. De même le ton est donné : celui de la raillerie caustique - celle qui vilipende les travers de notre société, une société qui a détruit la planète, laissé crever l’ozone contraignant les héritiers à vivre sous une cloche étanche… Dies irae. Dernier jour de l’ère « vroum-vroum »
Lecteur (avant le Jour d’après) et auditeurs bachelors aposters (de l’ère nouvelle) vont se confondre...
Marque du véhicule, kilométrage au départ et à l’arrivée, cote argus : le titre des trente trois chapitres qui composent le roman est une fiche signalétique ; la voiture commeinstrument de valuation. L’humain serait-il relégué au second plan...dans le monde chosifié des apparences ?. Et pourtant la plupart des personnages suscitent l’empathie voire la compassion. Voici entre autres Roland qui « roule » vers celle qui fut l’amour de sa vie, (si tu meurs Rolande je meurs), Sylvain qui conduit son petit Juju à Disneyland, Zoé -la croyante- qui travaille à la cafétéria de l’Arche, le couple Gruson septuagénaire qui se chamaille mais qui a gardé intacte la verve de leur 20 ans ; leur fils Frédéric chauffeur de poids lourd qui ne pense qu’à sa fille Océane, Claire et Jean-Yves Jourde un couple en rupture... Ils ont chacun une histoire et des flash-back plus ou moins longs en restituent les jalons. Les strates de leur passé qui se marie avec celui de l’Histoire (récente ou plus ancienne) créent un entrelacs d’échos, de glissements, de superpositions de fondus enchaînés (illustrés d’ailleurs par les changements de police ou de tonalité) ; un texte foisonnant protéiforme, qui renoue avec certaines traditions littéraires. Habitacle et vagabondage de l’esprit, habitacle et prise de conscience. Circonvolutions de la pensée et défilement sur l’asphalte. Pauses -les fameuses aires de repos- chemins de déviation- sorties ou plutôt marches arrière (pour comprendre le passé ?) Espace calligraphié et paysage intérieur ?Simultanément émergent tous les travers d’une société, -certains avaient été répertoriés dès le prologue. Les informations diffusées nous renseignent tant sur des faits divers dont certains assez glauques que sur des données économiques quand il ne s’agit pas de la presse dite people. Et comme le romancier a cherché le ton juste pour chacun des protagonistes (tics de langage, vocabulaire) Aires s’écoute comme une polyphonie. Celle de parcours dissemblables cahoteux ou pathétiques qui « roulent » sur le revêtement uniforme gluant entre 7h54 et 15h18, en ce lundi 6 août. La vie des gens avant le Jour d’après… avec leurs joies dérisoires leurs espoirs insensés leurs fêlures et déficiences
Un texte vibrionnant (sans connotation négative) à la verve satirique mordante, une écriture pleine d’allant qui pour éviter l’assomption de la complexité autant que la simplicité d’un rendu univoque, met en valeur un dispositif littéraire au service d’une réalité multiforme. La variété des formes de narration (récit, dialogues, histoire, cahiers à la chronologie éclatée) des registres (dramatique comique poétique même cf certains extraits des cahiers ou les rêves éveillés de Fédéric) des tonalités (humour, ironie, pathétique) des styles, de la typographie (polices italique caractères gras) et le sens aigu du détail en témoignent aisément. Et sans perdre de vue le statut inaugural, (un maître et ses aspirants graduates) le roman est ponctué par de brèves intrusions du narrateur (recommandations et commentaires qui s’adressent autant au lecteur du XXI° siècle qu’aux bachelors des temps futurs). Humour et autodérision quand l’auteur s’interroge sur la fonction, le métier d’écrivain et qu’il cite ses « confrères ». On devine aussi le plaisir du romancier à ciseler certains portraits telles des eaux-fortes (cf. les participants à la 99° session de l’OIT à Genève en 2010)
Comparable à un passager clandestin anonyme, le lecteur aurait-il quelque accointance avec l’auto-stoppeur sans identité, celui qui a brandi sa pancarte « Ailleurs » ? d’abord refusé par Catherine qui conduit (mal) une Lexus LS III puis accepté par Fred à bord de son camion fourgon Scania R114
Spectateur, ne vient-il pas d’assister à une Ronde des Temps Modernes….projetée sur l’écran des Vanités ?
Aïeux si différents et tellement semblables, nos frères
Assurément humain
-
"Girl" de Edna O'Brien (Editions Sabine Wespieser)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Roman traduit de l’anglais -Irlande- par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat
Avril 2014 : 276 lycéennes de 12 à 16 ans sont enlevées par Boko Haram au Nigeria (Chibok). Pendant trois ans la romancière irlandaise Edna O’Brien a mené une « enquête » (elle a interrogé des ex-captives, a rencontré des médecins, des représentants d’ONG, des religieux et des religieuses). En s’emparant de cette tragédie, elle rend lisible l’indicible en épousant le point de vue de la jeune Maryam (la madone noire). Elle invite ainsi le lecteur à suivre le chemin de croix de cette adolescente depuis son enlèvement jusqu’à son retour -où commencera d’ailleurs un autre enfer…
Ô femme-enfant au corps dépecé, à la parole confisquée que l’écriture d’Edna O’Brien ressuscite dans une langue où se mêlent réalisme et poésie, dialogues et récit et où le rythme épouse souvent la course pour la survie.
Écoutons ce monologue bouleversant, celui d’un destin brisé, celui de victime sacrificielle, incarnée désormais dans le Verbe ! Mais un verbe qui sait garder intact l’émerveillement devant une étoile ou un insecte sur le mur des supplices…
« J’étais une fille autrefois, c’est fini. Je pue. Couverte de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes entrailles, un bourbier » Un tel incipit frappe comme un uppercut émotionnel ! En quelques mots simples et glaçants le hurlement oppose un « avant » que l’on suppose lumineux (emploi de l’imparfait et constat sans appel « c’est fini ») à un « maintenant » purulent et irréversible ! (emploi du présent, champ lexical de l’avilissement, de la putréfaction).
Un avant revisité au cours du récit, par des flash-back (le dancing, les yeux du frère Youssouf, l’amour des parents...) qui, - échappés de lumière-, sont le contrepoint à l’horreur du quotidien. Un quotidien fait de tourments, d’humiliations -l’enlèvement à l’école, les tâches et prières imposées, les viols, les grossesses, les mariages avec les djihadistes. Et surtout cette détestation de soi. Et pourtant -malgré les yeux qui saignent, malgré la dislocation de l’être - quelle ténacité, quel acharnement à se « reconstruire » ! Une fuite avec son bébé Babby, une course contre la montre ; si frêle si fragile et pourtant si courageuse pour affronter l’inconnu le plus périlleux (le troupeau a fui vers où l’herbe est plus tendre, a fui le carnage et le fléau) et parfois la tentation d’en finir... Interrogée à un poste militaire Maryam résume en un paragraphe saisissant tout ce qu’elle a enduré, paragraphe scandé par « je dis » « je raconte » « je décris ». Mais l’aveu « je ne dis rien des sauvageries dans la maison Bleue » (en écho plus tard à sa mère « ne me demande rien » et face au psy « je lui dis des choses pour ne pas lui dire des choses ») prouve que la romancière fait de Maryam le sujet de sa propre vie : la jeune fille (girl) dira ce qu’elle veut bien dire ; en revanche la narratrice Maryam aura fait du lecteur son unique complice et ne lui aura rien épargné ; la trivialité toutefois est bannie dans le rendu de scènes au réalisme foudroyant : ainsi les viols et leur sordidité sont vécus de l’intérieur « j’ai eu l’impression d’être poignardée et encore poignardée », « une boucherie s’accomplit en moi », « nous étions trop jeunes pour savoir ce qui s’était passé ou lui donner un nom », « j’ai dit au revoir à mes parents et à tous ceux que je connaissais ». Déchirure fêlure indélébiles !
Dans l’avant-dernier mouvement (retour au village dans la famille) Maryam doit affronter une réalité insoupçonnée : elle, la victime, est désormais une coupable : l’Oncle, la mère, les habitants, tous la méprisent (n’est-elle pas la femme du bush, elle par qui le scandale est arrivé, elle la responsable de la mort du père et du frère, elle qui désormais souille la communauté ? Figée au même endroit où l’avait attendue vainement le père, elle attend Babby cet enfant confisqué et voué à disparaître (comme ces agneaux qui bêlent leurs derniers souffles en allant vers l’abattoir) ! Mais par un « retournement » de situation, Maryam accueillie au couvent, pourra contempler un ciel, dôme d’or de bout en bout d’un éclat si vif qu’on aurait dit que le monde était au seuil d’une nouvelle création.
À la fin du roman -qui est aussi la fin d’un parcours tortueux et torturant- Maryam peut saluer l’Aube nouvelle. Inscrivant son destin dans celui de l’univers tout entier, n’accède-t-elle pas au panthéon des héroïnes de tragédie qui ont marqué la littérature ?
Par-delà le cas particulier de Maryam, n’est-ce pas l’ensemble des jeunes femmes bafouées salies violées qui est convoqué dans ce cri d’effroi face à la barbarie sanguinaire ? Et c’est bien le viol en tant qu’arme politique, en tant que monnaie d’échange contre de la nourriture, « le rapport au monde le plus immédiat de l’enfer décrit » que fustige la romancière
« On n’a pas le pouvoir de changer les choses » confie la mère, résignée « parce qu’on est des femmes »
Un roman de la résistance où s’enchâssent plusieurs récits (mis en italique) ceux de John-John, Buki, Madara, Esaü, Rebeka, Daran comme autant de témoignages de l’humiliation de l’espoir et de la résilience ; un roman où des rites tels que l’exorcisme -confié d’ailleurs à une sorcière- côtoient des croyances ancestrales dans une perspective animiste -ne serait-ce que par l’interpénétration fusionnelle des règnes et des espèces…
Un roman aux couleurs pourpres de sang,Un roman de la lumière enténébréeUn roman à « la sombre splendeur » (cf 4ème de couverture)
-
"Un monstre et un chaos" de Hubert Haddad (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
En s’emparant du réel, d’un factuel vérifiable - le double asservissement des juifs du ghetto de Lodz aux nazis et au despote Rumkowski, qui avait conclu un pacte avec l’Ennemi esclavage contre survie -, Hubert Haddad cherche à le rendre palpable en l’incarnant dans le parcours/destin d’un enfant. Dualité et gémellité, réalisme cru et onirisme chagallien, traversent en un faisceau d’enchevêtrements une Déferlante, celle de l’Innommable ; alors que l’enfant à la blondeur botticellienne et à la souplesse féline, cet orphelin du chaos, à la chair déjà lacérée, à la mémoire déjà piétinée, semble porter en lui l’empreinte des vies échouées... (échos lointains avec l’enfant d’Opium Poppy ?)
Chant de la Douleur, de la Vie et de la Mort qui, dans cette fiction contre l’absurde, retentit de paroles et de musiques yiddish...
Du shtetl de Mirlek au ghetto de Lodz, l’auteur nous entraîne dans un véritable Cauchemar où le malheur collectif se conjugue avec celui d’un enfant. -Deux lignes/trajectoires : l’une inexorablement tendue vers la Mort, l’autre vers la (re)conquête de Soi se rencontrent se superposent bifurquent. Nous allons suivre le parcours d’Alter (ce prénom résonne d’emblée de multiples connotations) dans ses errances, sa quête de l’Autre qui est aussi quête de Soi, partager ses questionnements sur la monstruosité et le chaos. Le titre du roman -emprunté à Pascal et à Nietzsche- insiste précisément sur la sauvagerie de l’Homme dès lors qu’il a perdu toute humanité...Et la référence à Primo Levi -cité en exergue- n’en est que plus glaçante « c’est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau »
Au tout début l’emploi du pronom « nous » laisse supposer que le narrateur, Alter, forme avec son frère jumeau Ariel, un couple indissociable. Ce « nous » est relayé après la disparition du frère aimé, par un « il » (marque de la distanciation, de la dissociation) oul’enfant, le vagabond ; puis arrivé à Lodz Alter est contraint de changer d’identité : il sera « officiellement » Jan-Matheusza avant d’adopter le prénom du frère aimé dans son rôle de marionnettiste : il se produit sur la scène du théâtre Fantazyor (la devanture des songes) avec le violoniste nain Dumpf, et Bolmuche le fou de Shakespeare. Petit soldat de l’armée des anges, il a confectionné un pantin, son double, et les « deux » ainsi réunis forment un couple de pierrots lunaires. (l’expression est de Rebecca qui assiste aux répétitions). L’un est l’autre jusqu’à l’interprétation finale du chant des résistants de Varsovie…! De la fusion à la dislocation, (comme déporté hors de soi) de l’exclusion (dont le prénom serait la métonymie) à la dissolution... Et au recollement ? Ne serait-ce pas aussi la trajectoire du roman -en tant qu’interrogation sur la fiction et ses amers prolongements dans la réalité d’aujourd’hui ? N’est-ce pas celle vécue par une communauté ? Les brisures du vase laissent filtrer la lumière. Combien faudrait-il recoller de morceaux dissemblables comme les pièces d’un puzzle en trois ou quatre dimensions pour recouvrer la paix d’avant et presque le bonheur ?
Avec une certaine minutie l’auteur reconstitue ce que fut le ghetto Litzmannstadt ; des lieux, une ambiance, des odeurs que l’écriture fouille creuse en s’attachant aux détails -même les plus sordides- ! Un souffle épique palpite dans l’évocation de scènes où des humains ravalés au rang de Bêtes immondes forment une compacité de douleur et d’effarement, où la peur intensifie suspicion et défiance, où la maladie est l’antichambre de la mort, où le rendement dans les manufactures est synonyme d’esclavage, Foule rendue dolente par les privations... vouée à la déportation ! Le Monstre ? c’est bien évidemment l’inhumanité de la puissance qui a décidé l’extermination ; et dans le ghetto elle est incarnée par Hans Biebow. Mais c’est aussi la figure de la collaboration incarnée par Rumkowski - le doyen juif. Cet « histrion des bourreaux » croit galvaniser son auditoire en se prétendant émancipateur magnanime ; des arguments fallacieux ponctuent ses discours et particulièrement celui du 4 septembre 1942 -retranscrit en italique ; dans lequel il implore les familles de livrer leurs enfants de moins de 10 ans… Hans Biebow lui-même comprenait assez mal son énergie de petit caudillo et sa pusillanimité face aux dignitaires du Reich. Ce judéen négocie la survie des siens contre cent mille pièces de textile pliées et emballées, en chef d’industrie aussi véreux que pugnace dans un marché aux esclaves et aux chiens.
Mais dans cet Enfer, au cœur même du Désespoir, face aux « molochs de haine et d’acier » des îlots de résistance s’imposent -dans la clandestinité- et créent -dans le roman- un contrepoint dont la vibration célèbre le pouvoir de l’Art (plus que jamais les poètes nous sauvent) et bien vite se mue en une ode au yiddish (sans cette langue plus de peuple Itzkhok Peretz). Parmi les figures de résistants, citons le photographe Henrik Ross. Avec son "Leica 250 Reporter" suspendu à son cou il doit proposer des images convenues... (il travaille pour le bureau des identités et de la propagande). Mais à force de côtoyer l’Horreur -dont la pendaison de deux jeunes filles « bougies diaphanes étouffées dans le vent de la nuit » - il décide de filmer aussi « l’envers effarant du décor » : ce sera pour la Mémoire oublieuse, la preuve accablante et irréfutable de l’Ignominie ! Ou encore le Profesor Glusk qui après la mort de Gromeleck a pris à cœur la pérennité du journal clandestin ainsi que Shloyme Frenkel un chroniqueur.
Tout le texte d’Hubert Haddad retentit de refrains accompagnés de violons cymbales trompettes accordéons ou simplement chantés (chant de résistance éperdu, dit la 4ème de couverture). Au tout début on entend la berceuse chantonnée par Shaena, la mère des jumeaux, « shlof kindele shlof » Cette berceuse -du moins les premiers vers- viendra ponctuer à intervalles assez réguliers, des moments-clés du parcours (fût-il un songe) d’Alter/Ariel ; n’est-elle pas la formule magique qui guérit des fièvres et des sortilèges ? On chante en chœur Ot geyt ynkele (à la mémoire du poète Gebirig assassiné au ghetto de Cracovie) et c’est au final que retentira l’air du Partizanenlied…
De même on mime, on raconte des histoires d’évasion comme pour les colporter au-delà des barrières et transmuer la souffrance en mémoire Isaië Spiegel !
Écoutez-moi disait maître Azoï au théâtre des Quatre Sabots. Zet zhe kinderlekh vous autres près du fourneau ! Bientôt plus rien n’existera. Tant d’enfants et de jeunes partiront en fumée : ils ont refusé de plier l’échine. Mais je les vois se relever je vois leurs ombres vivantes. Il faut laisser la place à la petite flamme qui scintille et chanter et chanter la tête dans le fourneau.
On peut rendre le rêve plus grand que la nuit. (proverbe yiddish cité en explicit)
- replica hublot big bang
- replica rolex
- rolex replica
- richard mille replica watches
- replica richard mille
- fake richard mille
- richard mille replica
- replica richard mille watches
- richard mille replica watches uk
- richard mille replica
- replica richard mille watches uk
- fake richard mille watches
- luxury richard mille replica watches
- swiss replica richard mille watches
- réplicas de relojes Rolex
- réplicas de relojes
- réplicas de relojes cartier
- réplicas relojes
- replica uhren
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- répliques de montres rolex
- réplicas de relojes rolex
- fake rolex
- schweizer replica uhren
- gefälschte rolex uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica rolex uhren
- rolex replica horloges
- replica horloges
- panerai replica horloges
- luxe replica horloges
- orologi replica panerai
- orologi replica rolex
- falso rolex submariner
- rolex replica watches
- replica watches uk
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- rolex replica
- fake rolex watches
- luxury replica watches
- super clone watches
- répliques de montres rolex
- répliques de montres patek philippe
- fausses montres rolex datejust
- rolex replique montres
- répliques de montres rolex
- fausses montres rolex
- meilleure répliques de montres
- répliques de montres pour hommes et femmes
- boutique de répliques de montres
- répliques de montres
- répliques de montres suisses
- répliques de montres audemars piguet
- répliques de montres hublot
- répliques de montres rolex
- replica horloges
- réplicas de relógios
- cheap replica watches uk
- rolex replica watches uk
- fake rolex
- rolex replica watches
- Patek Philippe replica watches
- replica rolex watches
- swiss replica rolex watches uk
- hublot replica watches
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- Audemars Piguet replica watches
- rolex replica watches uk
- fake rolex watches
- rolex replica watches
- replica watches uk
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- luxury replica watches uk
- cartier replica watches
- Swiss replica watches
- replica watches
- omega replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- cheap fake rolex
- replica watches uk
- audemars piguet replica orologi
- orologi replica panerai
- migliori orologi rolex replica
- migliori orologi replica
- orologi replica rolex per uomo
- orologi rolex replica
- orologi rolex replica svizzeri economici
- orologi Rolex falsi economici
- orologi svizzeri replica Omega
- orologi omega replica svizzeri
- falso rolex sea-dweller
- orologi rolex replica di lusso
- svizzeri falso rolex
- falsi rolex submariner
- rolex replica horloges
- nep rolex horloges
- zwitserse replica horloges
- replica horloges nederland
- rolex replica horloges
- luxe replica horloges
- rolex replica horloges
- replica horloges nederland
- panerai replica horloges
- replica horloges winkel
- replica breitling horloges
- replica horloges
- omega replica watches
- omega replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica rolex watches
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- répliques de montres Rolex
- réplicas de relojes Rolex
- rolex falsos baratos
- réplicas de relojes suizos
- réplicas de relojes para hombres
- mejores réplicas de relojes
- réplicas de relojes
- rolex replica uhren
- replica uhren
- breitling replica uhren
- schweizer replica uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica uhren für herren
- omega replica uhren
- replica uhren für damen
- omega speedmaster replica uhren
- fake rolex submariner
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- rolex day-date replica uhren
- replica uhren
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- rolex replica watches
- replica rolex
- super clone watches
- fake rolex
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica watches uk
- fake watches
- replica watches
- richard mille replica watches
- replica watches uk
- rolex repliky hodinek
- švýcarské repliky hodinek
- falešné rolex
- repliky hodinek v ČR
- falešné hodinky rolex
- švýcarské repliky hodinek rolex
- repliky hodinek rolex
- repliky rolex
- repliky hodinek omega
- falešné rolex datejust
- repliky hodinek breitling
- luxusní repliky hodinek
- repliky luxusních hodinek
- repliky hodinek rolex v Praze
- levné falešné hodinky rolex
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact | www.mairie.com






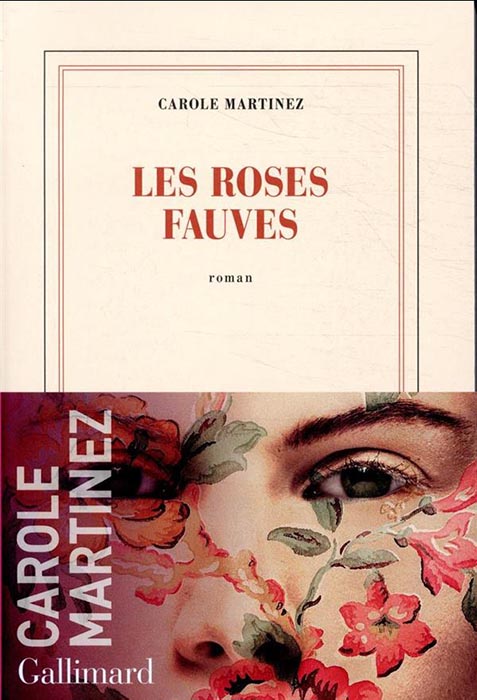

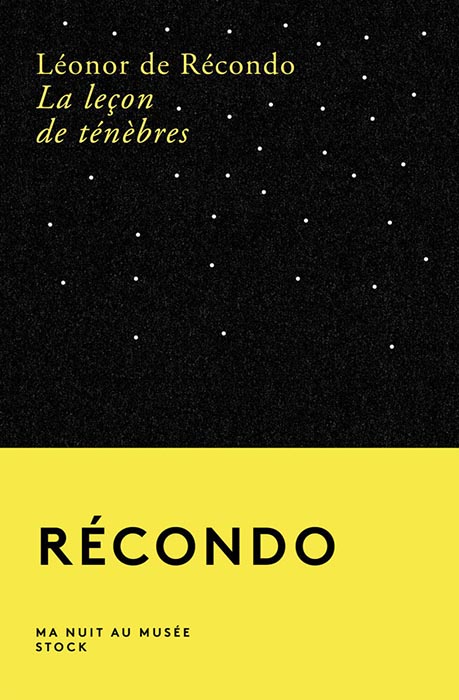


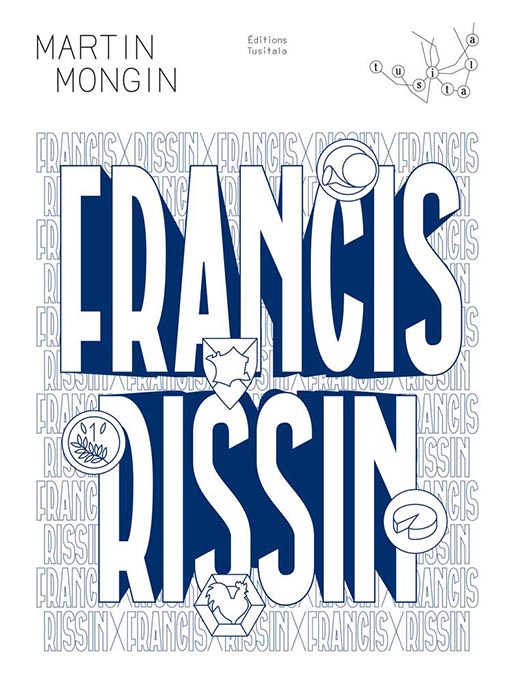

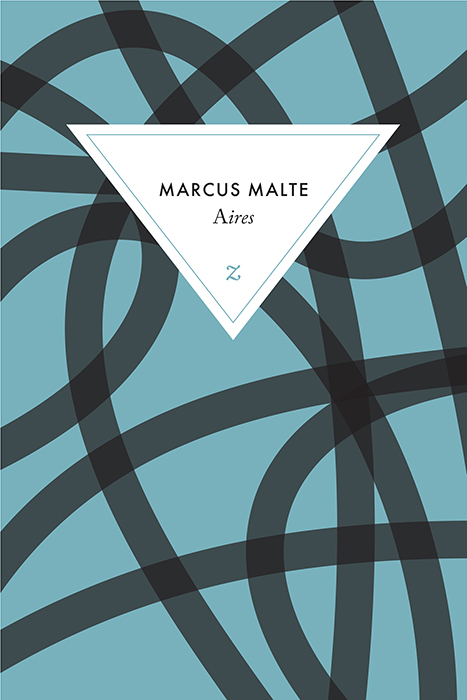
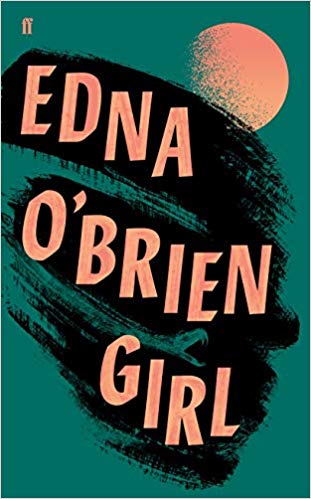
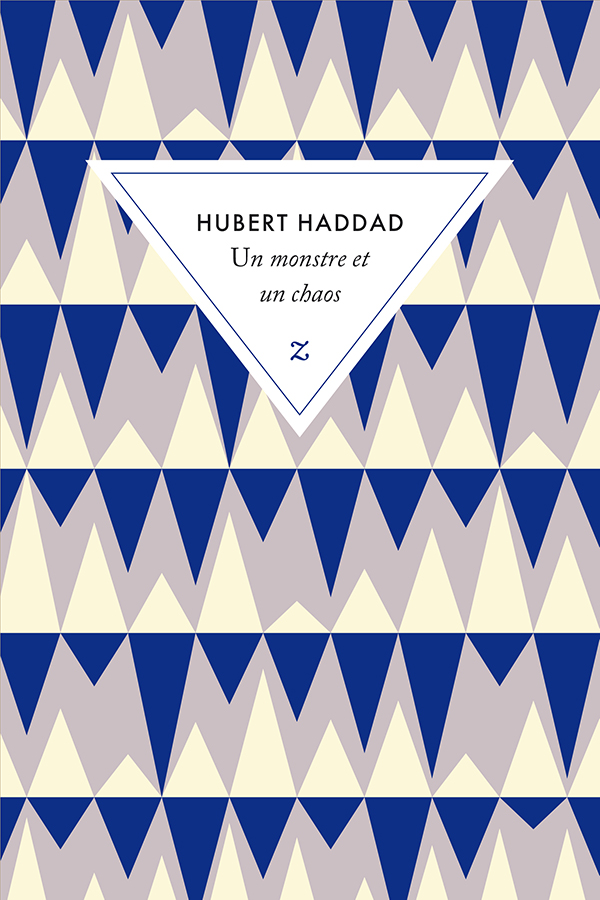
![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)